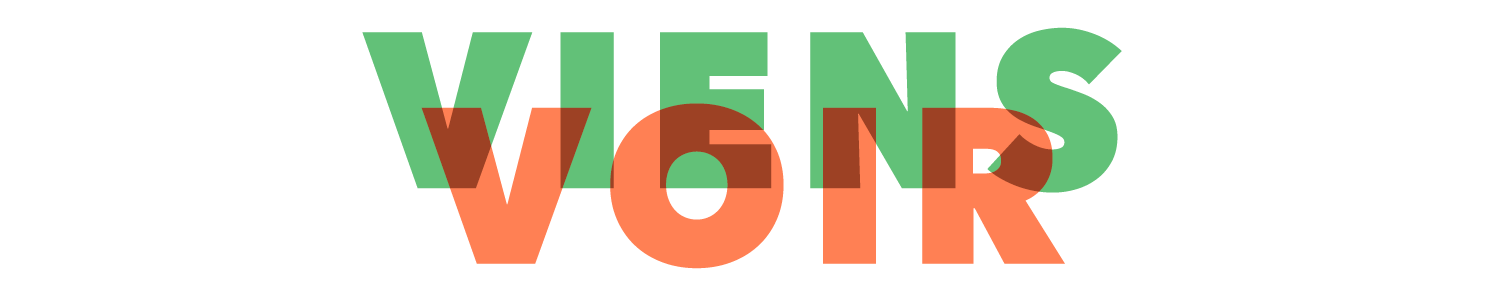Cet article inaugure une nouvelle série qui traite des rapports multiples entre texte et photographie. Nous sommes donc partis à la rencontre d’artistes dont la pratique entrelace les deux médiums. Pour arpenter les passages entre ce qui se dit avec des mots et ce qui se dit sans eux.
Premier épisode avec un parcours de vie et de création, celui de Louise Narbo.
Les prémices
Tu as publié de nombreux livres assemblant photographie et texte, et souvent même d’autres médiums, peux-tu nous expliquer comment cette pratique t’est venue ? As-tu des modèles, des influences dans ce domaine ?
Je suis venue à la photographie, dans les années 1980, grâce à des auteurs qui faisaient se rencontrer texte et image. Ça traitait, entre autres, de l’intime, de la question du deuil et de la vie amoureuse. En 1984, la lecture du journal d’Alix Cléo Roubaud m’a marquée profondément. Bien plus, elle m’a envoûtée. C’était un travail d’une liberté exemplaire. J’ai découvert, ensuite, le livre d’Hervé Guibert aux photos remarquables, sur ses tantes. Son texte, entièrement, écrit à la main, induisait une grande proximité avec lui. Lorsqu’il décida d’arrêter la photographie pour se consacrer à la littérature, je fus très déçue. En questionnant sa galeriste, Agathe Gaillard, sur les raisons de ce choix, « il lui a fallu choisir » m’a-t-elle simplement répondu. Denis Roche a beaucoup compté pour moi et Conversation avec le temps, le premier livre de lui que j’ai découvert, fut une révélation. J’ai eu le plaisir de le rencontrer dans son bureau du Seuil, pour lui présenter la maquette de mon premier livre, Coupe sombre, et j’ai vraiment apprécié son enthousiasme. Beaucoup d’autres auteurs que j’ai appréciés ont utilisé conjointement l’écriture avec la photographie. Je citerai, entre autres, Max Pam avec ses carnets de voyage, Peter Beard qui mêlait peinture, dessin et texte et enfin Duane Michals qui savait si bien, grâce à ses saynètes si singulières, analyser les mouvements de l’âme. Un peu plus tard j’ai découvert Anne De Gelas. Dans son journal et ses carnets, les textes pouvaient se présenter horizontalement ou verticalement, à la main ou à la machine, et la mise en page de ses photographies était extrêmement novatrice pour moi.
Pendant cette même période, je démarrais la photographie en autodidacte. Depuis les dernières années de collège, je tenais aussi, plus ou moins plus régulièrement, un journal. Quelques pensées, quelques rêves notés ici ou là. Après l’écriture, il y a eu la photo, mais avant l’écriture, le dessin me passionnait. Dès l’enfance, je rêvais de devenir peintre, mais il s’est avéré que je n’étais pas prête.
À la fin de l’adolescence, j’ai écrit un texte posant les bases d’une nouvelle religion. Ce texte a été perdu, mais je me souviens de l’essentiel : il s’agissait de retrouver, tout au long de notre vie, le même regard que celui de l’enfant découvrant le monde. Le bonheur venant de cette attention, toujours renouvelée, sur notre environnement visuel. Contrairement à mon père qui était malvoyant, je jouissais d’une bonne vue et ce projet rendait hommage, inconsciemment, au grand bonheur de voir.
C’est dans mes journaux que j’ai commencé à piocher les phrases que j’ai utilisées dans mon premier livre, Coupe sombre, publié en 2012. En général je les unissais intuitivement ou j’essayais de mettre en écho un tout petit détail commun aux deux mediums. Ces premières tentatives s’inscrivaient dans une mise en page assez sage et régulière. La lecture de la phrase devait se faire dans un temps équivalent à la lecture de l’image. J’appelais ça : l’union libre. C’est ainsi que pouvait se produire un double écho des médiums l’un sur l’autre.
Ce n’est qu’aux abords de l’année 2000 que j’ai commencé à écrire dans l’image. Je voulais rendre hommage aux rêves qui m’ont tant apporté tout au long de ma vie.
C’est pour exprimer la fragilité et le côté presque insaisissable des images oniriques que j’ai commencé à travailler, dans la chambre noire, sur l’envers du papier baryté. Cette technique donnait un certain velouté et un côté flottant à l’image, qui se rapprochait des images mentales.

J’ai toujours ressenti le besoin de réunir mes différents moyens d’expression car rassembler va dans le sens de la pulsion de vie. Cette dernière tente de réparer ce que la pulsion de mort a dévalorisé, sectionné ou détruit en moi, comme en chacun de nous. Le travail créatif est devenu une nécessité. C’est pourquoi je ne peux l’arrêter trop longtemps, sous peine d’engourdissement par les forces négatives. Je l’ai vérifié plusieurs fois lorsque j’ai cessé momentanément de créer. Une grande fatigue avec une impression de vide, d’absence à moi-même me submergeait, surtout si le jeûne se prolongeait. Lorsque je suis engagée dans un processus créatif, ce dernier est comme une alimentation psychique qui a toujours besoin de se renouveler. La création devient irremplaçable, car la pulsion de vie est en tension constante avec la pulsion de destruction et de mort.
Je me souviens que, à l’époque où j’étais psychothérapeute, je ressentais souvent une douleur assez pénible juste au moment où je devais quitter mes recherches photographiques pour aller dans le monde et faire face à la réalité extérieure. Ce déchirement, lié à cette séparation, se calmait lorsque j’arrivais dans les institutions où je travaillais. Mais la répétition systématique de ces difficultés a forcé ma décision d’abandonner ma pratique thérapeutique.
La naissance d’une passion
La naissance d’un goût ou d’une passion reste un moment très mystérieux. Mais j’en ai retrouvé quelques indices, en réfléchissant à tes questions. Je me suis souvenue que, lycéenne, une amie m’avait présentée à des artistes du mouvement Lettriste. Avait-elle vu mes petits poèmes ou mes gribouillis ? Je ne sais plus. C’était une jeune fille sensible et généreuse, qui avait dû capter quelques éléments de ma personnalité. Cette rencontre s’est passée dans un café faisant face à la Seine, à côté du métro St Michel. C’était probablement en 1966-67. Il y avait des poètes, des philosophes, des plasticiens et je revois aussi, sur un mannequin, une longue robe aux lettres peintes sur le tissu. Cette confrontation fut un choc, je me sentais face à une énigme. Pourquoi m’avait-elle amenée là, qu’est ce qui lui avait permis de penser que je pourrais faire partie de ce monde ? J’étais très jeune encore et issue d’un milieu où la place de la culture et des livres était assez restreinte. Introvertie, j’aurais voulu me sauver. Je n’ai donc pas donné suite à cette rencontre. Mais ce fut comme un petit tremblement intérieur qui a ébranlé l’image négative que ma famille et ma scolarité me renvoyait. Ce fut ma première rencontre avec un courant artistique.
Hier, je me suis hasardée à aller voir sur le net des informations sur le Lettrisme et j’ai été abasourdie de voir que certains artistes mélangeaient écriture et dessin, un peu comme j’ai commencé à le faire dernièrement dans un livre d’artiste. Il y a des rencontres que l’on ne considère pas suffisamment, que l’on rejette parfois dans les limbes de notre mémoire, mais qui peuvent resurgir quelques années plus tard.
Au fil des jours, j’ai constitué un petit Musée personnel sur mon ordinateur. Le choc que j’ai ressenti face à la puissance de certaines créations a resurgi parfois, plus ou moins consciemment, dans quelques-uns de mes travaux. Par exemple, j’ai beaucoup aimé Gerard Schlosser au tout début de ma pratique photographique. C’est un peintre, associé au mouvement hyperréaliste, qui a eu recours également à la photographie. J’aimais surtout l’union de ses grands titres sous ses peintures. Ces phrases dynamisaient l’image et la narration. Toute une sensualité se déployait autour de la banalité d’un moment d’oisiveté. Bien plus tard, lors d’une exposition dans une galerie de la rue du Perche qui présentait ses photomontages préparatoires, j’ai réalisé qu’une série de mes débuts, Les Roches blanches, fonctionnait un peu comme ses compositions. Des gros plans de corps segmentés, un milieu naturel et des différences d’échelle importantes entre le premier et le dernier plan.

Quelle est la spécificité propre à chaque médium, écriture et photographie ?
Comment leur exercice prend en charge, pour toi, quelque chose de différent ?
A quelles pulsions ou à quels moments de création obéissent-ils ?
Ma photographie s’est assez vite engagée sur la voie des autoportraits. En les faisant, je luttais contre mon sentiment d’immatérialité, dans ma jeunesse. Mon corps avait alors l’inconsistance du souffle, la transparence du fantôme. Plus tard j’ai compris que ces autoportraits étaient une sorte d’équivalent du cogito cartésien que je pourrais formuler ainsi : Je vois mon portrait photographique, donc je suis. La pratique de l’autoportrait n’est pas une marque de narcissisme. Elle était pour moi, une prothèse contre une défaillance narcissique et une angoisse de non-existence. L’image tirée sur le papier était plus convaincante que le reflet, évanescent, de mon visage sur le miroir. Plus concrète, elle était la preuve, le révélateur, de mon existence. Mes autoportraits venaient probablement fortifier des passages mal franchis d’une histoire archaïque.
L’alchimie entre
le texte et la photo
Dans les débuts de ma pratique photographique, il m’était difficile d’exprimer la violence du monde réel, le désespoir et l’injustice. J’ai rencontré cette difficulté également, longtemps plus tard, dans mon travail sur l’Algérie où la production d’images évoquant la guerre et le côtoiement de la mort pendant mon enfance, n’a pu émerger qu’en toute fin de parcours. Par contre, je pensais que, dans mes écrits, je pouvais davantage approcher mon côté sombre. C’était vrai en partie mais ce n’est pas avec les mots que j’ai pu faire face au refoulement de la guerre. J’ai dû dépasser le style classique de mes photographies argentiques monochromes, en intervenant manuellement dans mes images de différentes façons (déchirures, surimpressions, traits de peinture ou de dessin, écritures, compositions multiples …) pour que l’image me livre autre chose. C’est par cet acte que la photographie a pu représenter – encore partiellement – des émotions enfouies complexes et négatives. La honte par exemple, la peur aussi.
Que produit la présence d’un texte près d’une image ? C’est une opération qui se passe au niveau intuitif, je pense. On pourrait la penser comme un vide entre les deux, ou plutôt une case où quelque chose se déposerait, mais dont on n’a pas vraiment conscience. C’est juste une histoire de sensation, de trouble et d’interpénétration. C’est un travail sur les frontières. Lorsqu’une phrase côtoie une image, c’est un peu comme deux molécules chimiques qui entreraient en contact et produiraient un précipité. En photographie, ce précipité est assez peu visible et se traduit par une vague impression qui transforme la phrase et qui change l’image. C’est comme si leur face-à-face faisait trembler les limites de l’image ou de la phrase, c’est comme un tourbillon léger qui va troubler le sens de l’une et de l’autre. Et c’est ce floutage qui met différents objets en relation, qui les appelle et qui laisse entrevoir quelque chose d’autre, qui est différent pour chacun des lecteurs, mais d’abord pour le créateur. Une chaleur se diffuse hors cadre, une volupté difficile à caractériser. En chimie, ce précipité se dépose au fond d’un récipient sous la forme d’un cristal solide. Je suis à la recherche de ce cristal.

Le livre d’artiste
Est-ce qu’au cours des années et des expériences, ton rapport à l’écriture et à la photographie se sont transformés ?
Lorsque je me suis engagée dans la photographie, progressivement, le journal est devenu moins important et c’est l’image qui s’est imposée à moi. Côté écriture, je note toujours mes rêves et quelques souvenirs, mais le style est moins poétique à mon sens. Côté photographie, je suis passée de l’argentique classique, noir et blanc, à une photographie avec des insertions de textes écrits à l’intérieur de l’image. Puis est arrivé la couleur avec le numérique, la surimpression et l’écriture plasticienne avec différents types d’interventions, comme je l’ai évoqué un peu plus haut.
Actuellement, je me sens très attirée par la création de livres d’artiste. Après avoir réalisé des petits livres accordéon, que l’on nomme aussi leporellos, je me suis hasardée dans des projets plus complexes, voire plus ambitieux où j’intègre avec la photographie le dessin, la peinture et aussi l’écriture dessinée. Ce que je nomme écriture dessinée n’est pas seulement un texte écrit à la main avec un porte-plume et de l’encre de Chine. C’est, plus précisément, des phrases entourées d’élément graphiques nés sur le moment, et pas forcément reliés au sens de la phrase écrite. Dans tous ces domaines je suis également autodidacte. Je n’ai donc aucune maîtrise technique, mais j’espère que les accidents, les hasards et les maladresses pourront produire quelque chose d’inattendu. Encore faudra-t-il que le censeur intérieur ne m’assomme pas de ses jugements…

Un livre a plusieurs vies
Lors de notre entretien, tu m’as présenté une pratique très personnelle. La publication d’un livre n’en fige pas la forme, tu le prolonges, la rejoues, en complétant, réinterprétant un livre déjà publié. Comme pour lui inventer une nouvelle vie. Je crois que c’est très singulier. Peux-tu nous détailler la forme que cela prend et nous détailler le pourquoi ?
C’est une question bien difficile, comme beaucoup des tiennes. Bien sûr, la publication d’un livre demande des choix constants et notre travail, à peine terminé, est montré à une ou plusieurs personnes. Par exemple à nos premiers lecteurs, puis à des éditeurs, des graphistes. Côté lecteurs, il ne s’agit pas seulement des exigences de ceux qui achèteront le livre, mais aussi des exigences du lecteur qui s’installe intérieurement pendant la création. Il y a donc un certain nombre de concessions à faire pour que le livre soit accessible au public. Beaucoup de chutes d’images et d’idées. Et parfois de belles chutes sacrifiées à la fluidité de l’œuvre.
Dans certains cas, un livre fini et édité n’est, pour moi, qu’une partie du travail à un moment du processus. Il peut rester de la matière à exploiter ou des points à approfondir. Le livre d’artiste représente, à mes yeux, une expérience de liberté et de solitude. Je le pense comme une œuvre expérimentale utilisant, de façon non académique, différents médiums. C’est aussi un livre unique, dans tous les sens du mot car, si je décidais d’en produire plusieurs, tous les exemplaires seraient forcément différents du premier.
Travailler sur un sujet, c’est travailler sur moi-même. C’est reprendre des questions enfouies, des choses très personnelles qui exigent une certaine écriture pour émerger. Dès que le regard de quelqu’un se pose sur une image que nous avons produite, cette image change immédiatement à nos yeux. Elle devient un objet du monde extérieur, nous l’avons perdue.
Me voilà donc en grande difficulté puisque je pense, d’un côté, que le travail que je fais peut intéresser le monde, que j’ai envie de le transmettre car c’est le but de la création ; et de l’autre, que les exigences du monde me limitent. Récemment, une réponse s’est imposée, éditer un livre dans un premier temps, puis commencer un livre d’artiste si j’en ressens le besoin. Peut-être faut-il les deux pour me satisfaire pleinement ?
Lorsque j’ai travaillé avec Arnaud Bizalion sur le livre Chambre 812, il a eu l’excellente idée de me demander, pour les Rencontres d’Arles 2024, un livre d’artiste. C’est ainsi que j’ai réalisé un livre édité et des livres d’artiste qui lui ont succédé.

Rêvons ensemble : à quoi ressemblerait le livre avec des photographies qui te comblerait ?
Il m’est difficile de l’imaginer car je ne travaille pas avec une direction préétablie. Mais je vais essayer de te répondre.
Tout d’abord, ce livre ne contiendrait pas simplement des photographies, mais il réunirait plusieurs autres médiums. Il représenterait une avancée significative non seulement dans le dialogue entre textes et images, mais également dans l’interaction de tous les autres médiums utilisés : dessins, peintures, collages multiples… De plus, il marquerait une étape importante de ma pratique des arts plastiques. Et ces franchissements divers,pourraient exprimer, plus profondément encore, quelque chose de l’ordre de l’irreprésentable qui aura changé quelque chose en moi.
Le site de Louise Narbo
Le lien vers son dernier livre chez Arnaud Bizalion Editeur