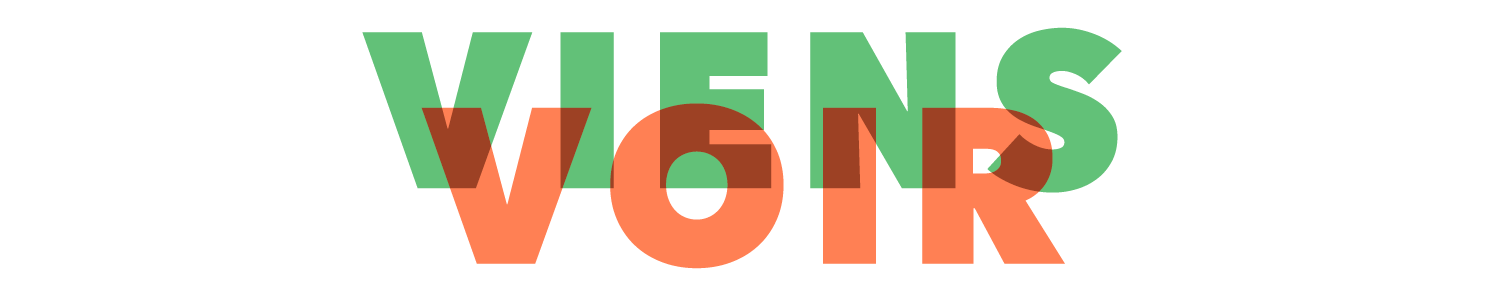Stéphanie Solinas s’aventure aux frontières de la photographie, pour mieux lui donner toute sa charge. A la découverte de cette photographie sans limites.
« Que faire du temps qui nous reste ? » C’est par cette phrase plutôt intimidante que s’ouvre « L’Être plus, Itinéraire pour Devenir soi-même », le dernier livre Stéphanie Solinas. Un texte absolument pénétrant qui se dévore comme ces polars dont le bandeau rouge nous promet, pour tout gage de qualité, une nuit d’insomnie. Le livre, nous y reviendrons un peu plus loin. Or, la bonne utilisation du temps qui me reste est une question que je me pose souvent. Ce questionnement commun ne m’a pourtant pas mis sur un pied d’égalité avec Stéphanie Solinas lors de notre entretien. En l’écoutant, j’avais souvent l’impression d’être un jeune garçon écoutant une aînée qui en sait bien plus long sur les choses de la vie. Une sensation inattendue qui inverse notre écart d’âge.
Stéphanie Solinas produit certes des œuvres, mais son art consiste tout autant à poser des questions qui n’appellent pas nécessairement de réponses. Elles ouvrent plutôt les champs de la réflexion, parfois jusqu’au vertige des espaces infinis, sondant en profondeur les mystères de notre existence.

A trop vouloir
l’invisible…
Je veux commencer par raconter un petit événement survenu pendant ma visite. Je ne sais plus très bien pourquoi mais, à un moment, je lui ai demandé si elle était elle-même une collectionneuse. Elle a spontanément répondu que non, parce que je n’ai pas envie de me charger d’une collection, à la fois parce que ça entraîne une responsabilité, mais aussi pour ce que ça représente physiquement (je crois qu’elle voulait signifier par là l’engagement physique qu’il y aurait à faire vivre sa collection). Elle s’est mise à réfléchir et a précisé que par contre, elle collectait des objets. Elle a réfléchi encore. Si. J’ai quelque chose. Des objets à moi, que je prélève, mais ce n’est pas vraiment une collection. Des petits cailloux qu’on trouve sur la route, des choses qui ont une histoire, qui m’importent et résonnent à un moment. Elle s’est approchée d’un placard, a fait coulisser une porte au niveau des yeux et, dans la niche obscure, j’ai confusément entrevu toutes sortes de formes. Comme je venais de photographier les tirages d’un autre projet qu’elle avait étalés sur la table, je pensais continuer et j’ai levé mon téléphone. Elle a brusquement refermé le vantail. Ah non, ça non ! J’avais à peine eu le temps d’entrevoir les objets, d’en approcher la forme, que déjà ils disparaissaient. A trop vouloir le fixer, je n’avais pas su voir l’invisible et l’avais aussitôt perdu. Je me suis senti idiot mais la leçon me profiterait.
Les limites
de la figuration
Lors de notre première rencontre, elle avait affirmé avec force son attachement au medium photographique. Six ans plus tard, je voulais savoir si elle l’assumait toujours, tant il me semblait qu’elle se détachait de plus en plus de la représentation figurative.
Stéphanie Solinas : je crois que oui. Selon moi, la photographie est suffisamment vaste pour accueillir une pratique qui se situe à ses limites. Ce qui m’intéresse beaucoup, c’est que la photographie est un outil qui a transformé la société qui l’a produite. Mon travail est ancré dans la photographie parce qu’il traite de ce que cet outil de représentation a apporté à ce que nous sommes aujourd’hui.
Mais est-ce que donner une représentation figurative du monde te motive encore ou est-ce que l’exploration des limites pourrait presque t’amener à en faire l’économie ? Mais je fais du figuratif ! Dans « Le soleil ni la mort », je photographie un coucher de soleil. Quelle image s’inscrit plus dans la grande histoire picturale qu’un coucher de soleil ? Cependant, je crois que même une image figurative parle de quelque chose qui n’est pas là. Par exemple, une photo d’identité, qui est supposée être juste informative et signalétique, reste en fait très éloignée de son sujet. Et ce, malgré la proximité qu’elle entretient avec lui à travers l’enregistrement direct. Ce type de photographie s’appuie sur tous les codes utilisés pour en faire un document policier et administratif et malgré tout ça, ça échappe.

Le potentiel
de la photographie
La dernière exposition de Stéphanie Solinas que j’avais vue, à la galerie Jean-Kenta Gauthier en avril 2023, était si intrigante, presque éthérée, que je voulais y revenir. Dans les expositions de Stéphanie Solinas, les œuvres semblent en équilibre sur un fil. Elles créent des réseaux de sens, frottent plus qu’elles ne ne se complètent. C’est aussi mystérieux que passionnant. Dans celle-ci, L’Épreuve du Monde, il y avait surtout ces quatre enveloppes de plastique noir destinées à protéger le papier photo argentique de la lumière qui pourrait le voiler. Conversions potentielles (Vierge/Voilé) est d’ailleurs le titre de cette pièce : on retrouve toute la richesse sémantique de l’oeuvre. Quatre enveloppes comme autant de présages impénétrables ayant voyagé du Vatican à la Villa Medicis.
Je voulais que Stéphanie Solinas me parle de ces enveloppes et de leur potentiel photographique. Comment articuler cette puissance invisible contenue à l’intérieur et, en même temps, la matérialité physique de l’enveloppe ? Ça, c’est tout mon travail. Et c’est une équivalence de ce que nous sommes. Ainsi, en ce moment, je suis à la fois face à toi, avec ce corps, ces vêtements et cette coupe de cheveux, et puis, en même temps, coexiste tout ce à quoi nous n’avons pas accès malgré cet échange, concret, tangible. Cette question m’apparaît très liée à la photographie et je me la suis posée dès mes premiers travaux de recherche. Je me souviens ainsi que, lorsque j’étais à l’école Louis Lumière, j’étais déjà intriguée par tout ce qu’il y avait autour de l’acte du portrait. Je sentais qu’il se passait tellement de choses par-delà l’image… Il fallait que je comprenne mieux ce qui se passait à cet instant-là. Et j’ai donc poursuivi par un doctorat sur ces questions puisque ma thèse s’intitulait « Photographie et identité, images du corps surveillé ». Ma thèse m’a permis de structurer un territoire de recherche.

Photographie
et mystère
Ces questions te poursuivent encore ? Oui et ce sont toujours les mêmes. Qu’est-ce qui nous constitue ? Qu’est-ce que nous sommes ? Entre quelque chose de très visible, tangible, corporel, et d’autres éléments beaucoup moins visibles : les générations qui nous ont précédé, nos croyances, notre mémoire.
Nous revenons à ces fameuses enveloppes noires présentées dans l’exposition. Il n’y a rien à voir et en même temps, ce Rien n’est pas rien. Il y a un lien avec mon travail intitulé Déserteurs (un inventaire des photographies manquantes sur les tombes du cimentière du Père-Lachaise présenté actuellement dans l’exposition Corps à Corps au Centre Pompidou) où il ne reste rien à voir. Et ça nous interroge sur ce Rien. Cette enveloppe, c’est aussi quelque chose qui résiste, qui n’est pas donné entièrement, qui est accessible mais dont on ne peut pas se saisir pleinement. Il y a une résistance du visuel, une résistance du sens aussi, que l’on peut éprouver face à la matérialité de l’enveloppe. Et bien sûr, ça a à voir avec le mystère…
Le corps
et l’esprit
Comment envisages-tu la dimension religieuse ? Tout le chapitre italien de mon travail tourne autour de la question du miracle dans la foi catholique. Pour qu’un miracle soit reconnu en tant que tel dans la religion catholique, il faut que soit réunie une assemblée de scientifiques qui reconnaissent le caractère inexpliqué du phénomène en l’état actuel des connaissances. Quand la science admet être arrivée au bout de la rationalité, les instances religieuses décident alors de proclamer (ou pas) le miracle. A partir de point d’entrée, j’ai créé plusieurs pièces autonomes. Pour l’une d’elles, « La mort de la Céleste Oculiste », j’ai passé plusieurs semaines dans les archives secrètes du Vatican afin de consulter le procès en canonisation de Thérèse de Lisieux. J’ai conservé les huit témoignages des sœurs qui étaient autour d’elle à l’instant de son dernier soupir. Thérèse meurt en extase et ce sont huit récits différents de ce même instant crucial. Et je suis actuellement en train d’écrire la partie textuelle de ce chapitre italien.

Que l’on n’imagine pas pour autant le travail de Stéphanie Solinas se dissoudre dans les sphères de l’esprit. Il peut aussi se concrétiser en des expériences beaucoup plus engagées physiquement. Ainsi lorsqu’elle recouvre avec un marqueur noir les deux cent quarante tirages de la série Les Hommes-Forêts (https://www.stephaniesolinas.com/inex-hommes-foret) afin d’isoler, pour mieux les faire ressortir, les mains des habitants manipulant les serpents lors de ce rituel ancestral. A travers ce geste de caviardage que mon corps a répété pendant des heures, j’ai aussi approché une certaine dimension spirituelle. Dans le glissement du feutre, il y avait quelque chose de la sensualité du rapport avec le serpent, pendant que je me confrontais à ma propre peur de cet animal.
Une exploration
narrative
De l’Italie nous nous transportons dans l’ouest américain, avec son dernier projet, matière du livre évoqué en ouverture de cet article. Elle y développe une forme d’exploration narrative qu’elle considère comme une pièce plastique. Depuis bientôt dix ans, mes recherches se sont poursuivies sur trois terrains (l’Islande, l’Italie, l’Ouest américain) Ces territoires représentent des points d’entrée pour éclairer les questionnements que nous avons déjà évoqués. Il s’agit de connecter des lieux et des personnes qui, chacune à leur manière, façonnent le réel. Et j’étais intéressée par le fait que l’Ouest américain soit à la fois le lieu où s’est développée la Silicon Valley, à la pointe de la construction de nos identités numériques mais aussi le mouvement du New Age.

Je demande à Stéphanie s’il y a des penseurs et des penseuses important.es qui sont des références fortes pour elle. Pas forcément. Il y en a (elle cite Carlo Ginzburg, Michel Foucault, Simone de Beauvoir) mais, ce qui ressort notamment dans mes propositions de livres, c’est essayer de faire l’expérience d’une forme de savoir et de connaissance horizontale. Recueillir une parole vivante.
Qu’est-ce que tu rêves de photographier ? Je répondrais : l’invisible et pourtant, dès que je le formule, je crois qu’une part de moi accepte de plus en plus qu’il y ait du non-photographiable, certaines parts de nous et du réel qui nous sont inaccessibles,. Dans toutes ces recherches j’explore la porosité entre science et croyance, ce qui me donne aussi accès à certains aspects, de moi ou des autres qui ont été escamotés, mis sous le tapis.
Tu es une chercheuse-artiste ? Moi je dis que je suis artiste, c’est le point à partir duquel j’ai envie de parler. Et au fond, tout artiste est chercheur.
Le site de Stéphanie Solinas
Stéphanie Solinas est représentée par la Galerie Jean-Kenta Gauthier