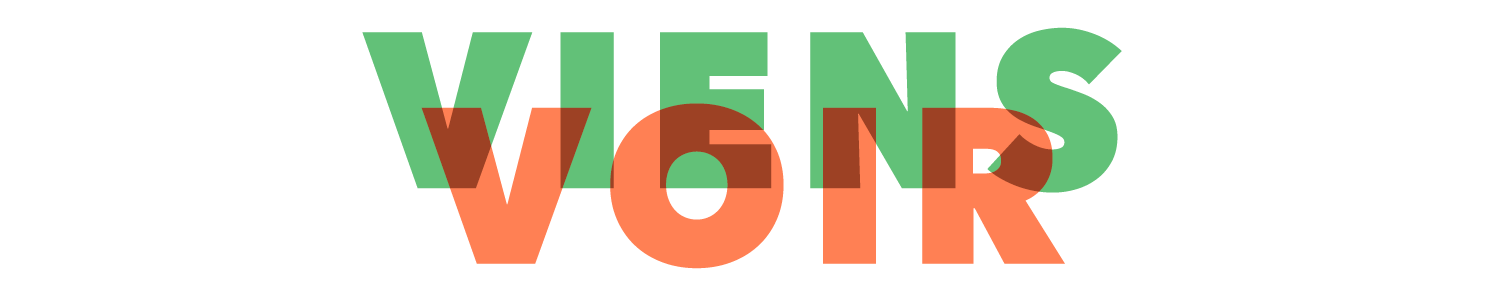(English version included below)
L’arrière-monde de l’artiste Fabien Dettori et son horizon pictural.
Etrangement, tout commence par un rendez-vous manqué. Fabien Dettori avait souhaité me faire visiter l’exposition à laquelle il participait à la Galerie Thierry Bigaignon. Mais à l’heure dite, il n’y avait personne et je visitai l’exposition seul. Je lui envoyai ensuite un message dont le laconisme masquait à peine mon désagrément et il me répondit alors avec une telle sincérité que je compris que ce qui le désolait n’était ni une question de convenance, ni le fait d’avoir laissé échapper une oppportunité journalistique, mais vraiment le fait d’échanger autour de nos conceptions artistiques.
Peu de temps après, l’écriture d’un article s’interrogeant sur la vogue du kintsugi fut l’occasion d’une première rencontre dans son atelier (à lire ici). D’autres allaient suivre, renforçant une confiance parfois complice.
La plupart des artistes séparent le lieu de l’entretien de celui de leur création, là où se passe la cuisine de l’art, à laquelle jamais le chroniqueur n’assiste. Soit qu’il y ait là des recettes secrètes, soit que la présence d’un observateur modifie le processus créatif. Fabien, lui, se livre entièrement, avec simplicité et générosité, se montrant aussi bien en action, en shooting photo avec son modèle ou manipulant les polaroids à sa table de travail. Comme s’il n’y avait rien à cacher, rien à protéger, mais plutôt, tout à dire, tout à donner. Un vrai paradoxe pour une pratique artistique qui sait si bien jouer de la pénombre et du clair-obscur.

La plupart du temps, Fabien me reçoit avec sa blouse blanche maculée de taches diverses (un vêtement fétiche puisqu’il a appartenu à sa mère, peintre), un look quelque part entre l’orfèvre, le chercheur inlassable et le savant fou. Dans un compotier, une grappe de raisin achève de se flétrir, deux citrons dont le jaune se pique de beige, quelques citrouilles moisissent. Quand je reviendrai, quelques semaines plus tard, ils seront toujours là et, comme la première fois, Fabien s’extasiera devant leurs couleurs en les faisant tourner dans la lumière. Et s’emparant d’une branche morte à laquelle s’accrochent encore quelques feuilles, il ressuscitera le mot précieux de marcescence.
Certains artistes vivent dans leur atelier, s’aménageant un coin pour dormir et cuisiner ; d’autres séparent fermement le lieu de vie et celui du travail, s’astreignant à une discipline et à des horaires. Chez Fabien, la maison et l’atelier sont totalement imbriqués. Les chambres se transforment en studio, la table du salon est recouverte d’épreuves en cours de transformation, les livres d’art sont partout.
Mais mon lieu préféré, c’est encore la cave. J’y suis retourné parce que c’était là qu’il me fallait faire son portrait. Dès les premières marches (attention à ta tête, Bruno), on pénètre dans un cocon d’un fabuleux désordre. S’y accumulent cartons, appareils photo, traceur, produits chimiques, cartons de matériel, installations destinées à la prise de vues ou au travail sur les tirages dans une sédimentation qui tient autant de l’urgence de créer que de l’enveloppement de l’enfance. On n’y avance qu’à pas mesurés, comme un échassier. Et la table de travail reproduit cette densité anarchique. L’artiste dans son fauteuil, comme dans un poste de pilotage, face aux tableaux de bord des possibles artistiques, devant la lumière venant du soupirail.

J’y ai pris le portrait de Fabien, penché sur le polaroid qu’il scrute et palpe intensément. J’ai su instantanément que c’était la bonne image parce que j’ai pensé, en la regardant, aux photos de Bill Evans, un pianiste de jazz qui me touche au plus profond, recroquevillé au-dessus du clavier dans cette pose alambiquée. Résonance, puisque Fabien Dettori, à un moment de sa vie, quelque part entre photographe de mode et aujourd’hui, a été producteur de musique.
Et puis, cet article pourrait être comme ces films de Tarantino qui changent d’esthétique en un claquement de doigts, passant d’un noir et blanc vintage à la couleur contemporaine, du réalisme au dessin animé. La première partie aurait été un film classique aux couleurs étouffées, un huis-clos expressionniste avec des dialogues chuchotés. On y parlerait d’émotion, de poésie et de lenteur. La seconde serait beaucoup plus nerveuse.
Tiens, comme un Tarantino, justement. Série B, film noir (toujours la nuit). Il y aurait des dialogues plus trash, des filles aux longues jambes, de la vitesse, de la vie, oui, mais sur le fil du rasoir. Du danger. Un truc violent, un stress, les mains qui tremblent. J’oxyde l’or comme un souvenir qui se corrode, dit Fabien à propos de ses interventions sur les polaroids qu’il déchire avec délicatesse ou brutalité, c’est selon. Je suis un punk.
Un punk qui n’aurait à la bouche que des noms de peintres aujourd’hui devenus classiques, mais éminemment subversifs en leur temps : Courbet, Schiele, Rodin, Delacroix. Des peintres qui sont là, derrière ses images, pas forcément comme de pures références (quand je fais vraiment référence directement à un tableau, c’est que je manque de confiance), mais plutôt comme un univers réapproprié, un arrière-monde. Des poses, des lignes de composition, des ombrages, des fulgurances colorées.
Bon, mais les artistes vous racontent parfois des trucs, vous impressionnent et vous emmènent assez loin de leur oeuvre. Il fallait sentir, il fallait voir. Et Fabien m’avait dit : écoute, je suis pendant dix jours à Paris, en immersion avec un modèle, Marisa Papen, et je vais lui demander si elle est d’accord pour que tu assistes à une séance. Pour moi, c’était parfait. Au moment d’accepter, je ne savais pas encore que Marisa avait été élue plus belle femme d’Instagram, et que l’une des particularités est de vivre et de poser nue.
Donc interview. Marisa, nue, évidemment. Nous parlons du projet qui les réunit autour d’images detinées à s’élever contre la censure de la nudité et surtout, de leur méthode de travail, cette fameuse immersion. Peu de règles entre eux, une seule : si une image produite ne plait pas à l’un ou l’autre, il a le droit de la détruire (souvenons-nous que ces photos sont des Polaroid, donc à chaque fois un exemplaire unique). Mais comme un pied de nez à la règle qui vient d’être édictée, Fabien exhibe un Polaroid déchiré le matin même et qu’il a reconstitué en le modifiant avec ses sortilèges chimiques. Marisa le considère à nouveau et fait une moue amusée devant cette transgression. Tous deux parlent de liberté sans rien occulter de la difficulté ni de la douleur qui peuvent lui être associées.
Shooting. Lumière zénithale, une simple table en bois, une bâche noire qui pendouille sur le mur (c’est décevant, non ? On dirait un studio de MJC). Ils jouent à poser pour moi. Il y a des rires, des décisions rapides, prises sur un regard. Puis, Marisa, de dos, la jambe repliée, Fabien ajuste la courbure de la hanche, cadre, encourage.

Assister à une prise de vue qui va générer une création, c’est toujours une expérience un peu destabilisante, porteuse d’un écart : je photographie leur interaction mais je sais que mes yeux ne sont pas les leurs, qui voient au-delà.
Après tout, c’est peut-être à ça que servent les oeuvres d’art : nous permettre de voir le monde avec d’autres yeux.

@dettorifabien et @marisa_papen_fans sur Instagram
English version
Fabien Dettori, the photographic painter
Strangely, it all starts with a missed appointment. Fabien Dettori had wanted me to visit the exhibition in which he was participating at the Thierry Bigaignon Gallery. But at the time, there was no one there and I visited the exhibition alone. Then I sent him a message whose laconism barely masked my discomfort and he answered me with such sincerity that I understood that what saddened him was neither a matter of convenience, nor the fact of having missed a journalistic opportunity, but really the fact of exchanging around our artistic conceptions.
Shortly afterwards, the writing of an article questioning the vogue of the kintsugi was the occasion of a first meeting in his workshop (here). Others would follow, building trust that was sometimes complicit.
Most artists separate the place of the interview from the place of their creation, where the cuisine of art takes place, which the chronicler never attends. Either there are secret recipes there, or the presence of an observer changes the creative process. Fabien, on the other hand, gives himself up entirely, with simplicity and generosity, showing himself as well in action, in photo shoots with his model or handling polaroids at his work table. As if there was nothing to hide, nothing to protect, but rather, everything to say, everything to give. A real paradox for an artistic practice that knows how to play with penumbra and chiaroscuro so well.
Most of the time, Fabien receives me with his white coat stained with various stains (a fetish garment since it belonged to his mother, a painter), a look somewhere between the goldsmith, the tireless researcher and the mad scientist. In a compotier, a bunch of grapes finishes withering, two lemons whose yolks are pricked with beige, a few pumpkins become mouldy. When I come back a few weeks later, they will still be there and, like the first time, Fabien will be thrilled by their colours by turning them in the light. And grabbing a dead branch to which a few leaves still cling, he will resurrect the precious word of marcescence.
Some artists live in their studios, setting up a corner to sleep and cook; others firmly separate the place of living and work, requiring discipline and schedules. At Fabien, the house and the workshop are totally intertwined. The rooms are transformed into a studio, the living room table is covered with prints being transformed, art books are everywhere.
But my favorite place is still the cellar. I went back because that was where I had to do his portrait. From the first steps (watch your head, Bruno), you enter a cocoon of fabulous disorder. Cardboard boxes, cameras, tracers, chemicals, equipment boxes, installations intended for taking pictures or working on prints in a sedimentation that is as much about the urgency of creating as it is about wrapping up childhood. We only move forward at a measured pace, like a wader. And the work table reproduces this anarchic density. The artist in his armchair, as in a cockpit, facing the dashboards of artistic possibilities, in front of the light coming from the window.
I took Fabien’s portrait there, leaning over the polaroid that he scrutinizes and feels intensely. I knew instantly that it was the right image because I thought, when I looked at it, of the photos of Bill Evans, a jazz pianist who touched me deeply, huddled above the keyboard in this convoluted pose. Resonance, since Fabien Dettori, at one point in his life, somewhere between fashion photographer and today, was a music producer.
And then, this article could be like Tarantino’s films that change aesthetics in a finger snap, from vintage black and white to contemporary colour, from realism to cartoon. The first part would have been a classic film with muffled colours, an expressionist huis-clos with whispered dialogues. We would talk about emotion, poetry and slowness. The second would be much more nervous.
Here, like a Tarantino, that’s just it. B-movie, film noir (always at night). There would be more trashy dialogues, girls with long legs, speed, life on the razor’s edge. Danger. Something violent, something stressful, hands shaking. I oxidize gold like a memory that corrodes, Fabien says of his interventions on the polaroids that he tears up with delicacy or brutality, depending on. I’m a punk.
A punk who would only have in his mouth the names of painters who have become classic today, but eminently subversive in their time: Courbet, Schiele, Rodin, Delacroix. Painters who are there, behind his images, not necessarily as pure references (when I really refer directly to a painting, it’s because I lack confidence), but rather as a reappropriated universe, a background. Poses, composition lines, shades, colourful fulgurations.
Okay, but artists sometimes tell you things, impress you and take you quite far from their work. You had to feel, you had to see. And Fabien had told me: Look, I’m in Paris for ten days, immersed with a model, Marisa Papen, and I’m going to ask her if she agrees that you should attend a session. For me, it was perfect. At the time of accepting, I didn’t know yet that Marisa had been elected the most beautiful woman in Instagram, and that one her particularities is to live and pose naked.
So interview. Marisa, naked, of course. We are talking about the project that brings them together around images detached from the censorship of nudity and above all, about their working method, this famous immersion. Few rules between them, only one: if an image produced does not please one or the other, he or she has the right to destroy it (remember that these photos are Polaroid, so each time a unique copy). But like a thumbnail to the rule that has just been enacted, Fabien shows off a Polaroid torn that very morning and that he has reconstructed by modifying it with his chemical spells. Marisa considers him again and makes an amused pout at this transgression. Both speak of freedom without concealing anything of the difficulty or pain that can be associated with it.
Shooting. Zenithal light, a simple wooden table, a black tarpaulin hanging on the wall (it’s disappointing, isn’t it? It looks like an MJC studio). They’re playing posing for me. There are laughter, quick decisions, made at a glance. Then, Marisa, from behind, with her leg bent, Fabien adjusts the curvature of the hip, frame, encourages.

Attending a shot that will generate a creation is always a somewhat destabilizing experience, carrying a gap: I photograph their interaction but I know that my eyes are not theirs, that they see beyond.
After all, perhaps that’s what works of art are for: to allow us to see the world with different eyes.
@dettorifabien et @marisa_papen_fans on Instagram