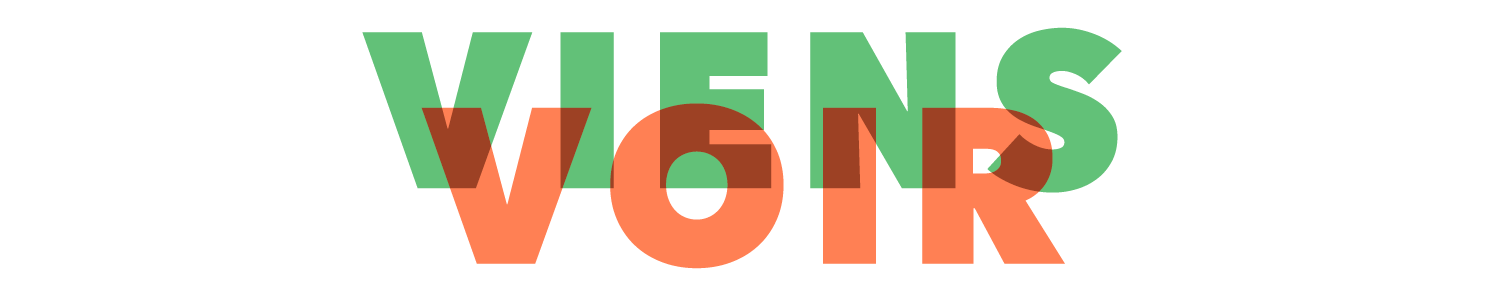Rendez-vous incontournable de l’été photographique, les Rencontres d’Arles soulèvent leurs vagues d’enthousiasme ou d’irritation. Si on laissait le palmarès de côté pour soulever quelques questions à propos des expositions de cette année ?
Proposer une lecture critique se réduit souvent à une forme d’évaluation d’un objet par rapport à d’autres. S’agissant d’un festival, le comparer aux éditions précédentes, ou à d’autres manifestations du même type. L’exercice n’est pas vain mais génère une pensée un peu éphémère qui sera oubliée l’été suivant. Une pensée pas forcément productrice de sens. Tentons une autre lecture.
Aujourd’hui, avec le recul nécessaire, quelques impressions persistent, positives ou négatives. Elles mettent au centre de la réflexion les attentes par rapport à une manifestation photographique forte de cinquante années d’existence et d’expérience, et la prise en compte de publics dont la familiarité avec le medium est forcément inégale.
Personnellement, j’attends d’une telle manifestation qu’à travers ses expositions et évènements, elle s’appuie historiquement sur une pratique (la photographie donc) pour en explorer les marges et en tracer le futur périmètre.
A en juger par cette édition, c’est une vision partagée, ce qui est plutôt réjouissant : expositions historiques brillantes (Corps Impatients, photographie est-allemande 1980-1989), exploration des marges (La Saga des Inventions, Photo / Brut). Reste que les directions futures sont surtout représentées par les Prix Découvertes, vraiment trop engoncés dans leurs petits espaces, et qui mériteraient un déploiement plus large.
Mais là où le bât blesse trop souvent à Arles, c’est au niveau du commissariat d’exposition et de l’accrochage.
En guise de symptôme, l’exposition de Philippe Chancel, Datazone (photographe dont le travail et le projet sont, par ailleurs, tout à fait respectables) à l’église des Frères Prêcheurs, véritable cacophonie de formats (au moins vingt différents) et de modes d’accrochages : en haut, en bas, en ligne, en grille, à plat, suspendus au plafond et j’en oublie. La photo sous toutes les formes, dans tous les sens : ça pourrait évidemment avoir un sens, mais ici ça n’en a pas.

Je l’affirme sur ces pages régulièrement : il n’est pas indifférent que la photo soit de grande ou de petite taille, qu’elle soit accrochée à hauteur des yeux ou qu’elle flotte dans l’espace d’exposition, dominant le spectateur (prenons en compte le corps du spectateur !), qu’elle soit présentée en ligne ou en constellation. Ces variations de présentation modifient non seulement l’accès au contenu de la photo, mais son contenu lui-même. Aujourd’hui, le photographe contemporain ne peut pas éviter d’intégrer cette partie du rapport à l’image à sa réflexion.
Il faut alors poser une nouvelle fois cette question du curating confondu avec la scénographie. Et dire que la photographie n’a pas grand chose à gagner à se considérer comme une matière totalement malléable par la scénographie. Poser ainsi une identité entre les différentes modalités d’apparition de l’image ( taille, encadrement et mode de présentation) ne fait que renforcer l’idée selon laquelle la photographie ne serait rien d’autre que son contenu, sa référence au réel. Cette conception n’a nul besoin d’être mise en avant, encore moins renforcée : elle est souterrainement à l’oeuvre pour une partie du public. Elle contribue alors à banaliser l’expérience du regard, lequel a plus besoin d’exigence et de rigueur que d’imprécision et de variété gratuite.
Insistons : l’exposition, elle aussi, est un medium. Exposer, ce n’est pas seulement juxtaposer. Exposer peut consister à découper, catégoriser, thématiser (c’est la forme la plus courante des expositions arlésiennes). Mais exposer, c’est surtout frotter les oeuvres les unes aux autres, pour créer du sens. Agir pour transformer.
C’est ce que réussit très bien la maison de The Anonymous Project. La mise en installation (pour le coup on pourrait parler de scénographie) décharge ces photos vernaculaires de leur dimension pittoresque, éventuellement nostalgique, pour concentrer le regard sur la composition, les isoler d’un contexte pour concentrer le regard sur la dimension esthétique et psychologique des photos.
 Enfin, l’exposition peut parfois être victime de limites qu’elle s’impose elle-même. Je pense ici à l’exposition Germaine Krull & Jacques Rémy, un voyage Marseille-Rio 1941. Un fascinant récit de voyage qui aurait pu appeler une scénarisation aussi riche que le matériau de départ, une véritable création entremêlant photos, documents et lettres alors qu’ici, on a plutôt le sentiment que l’identité visuelle des cartels et des textes (graphisme adopté dans la plupart des expositions du festival) interdit de prendre des partis-pris narratifs. L’exposition est si classique qu’elle en devient terriblement conventionnelle alors qu’elle appelait l’invention débridée de formes de narration texte-image.
Enfin, l’exposition peut parfois être victime de limites qu’elle s’impose elle-même. Je pense ici à l’exposition Germaine Krull & Jacques Rémy, un voyage Marseille-Rio 1941. Un fascinant récit de voyage qui aurait pu appeler une scénarisation aussi riche que le matériau de départ, une véritable création entremêlant photos, documents et lettres alors qu’ici, on a plutôt le sentiment que l’identité visuelle des cartels et des textes (graphisme adopté dans la plupart des expositions du festival) interdit de prendre des partis-pris narratifs. L’exposition est si classique qu’elle en devient terriblement conventionnelle alors qu’elle appelait l’invention débridée de formes de narration texte-image.
Dans exposer, il y a oser.