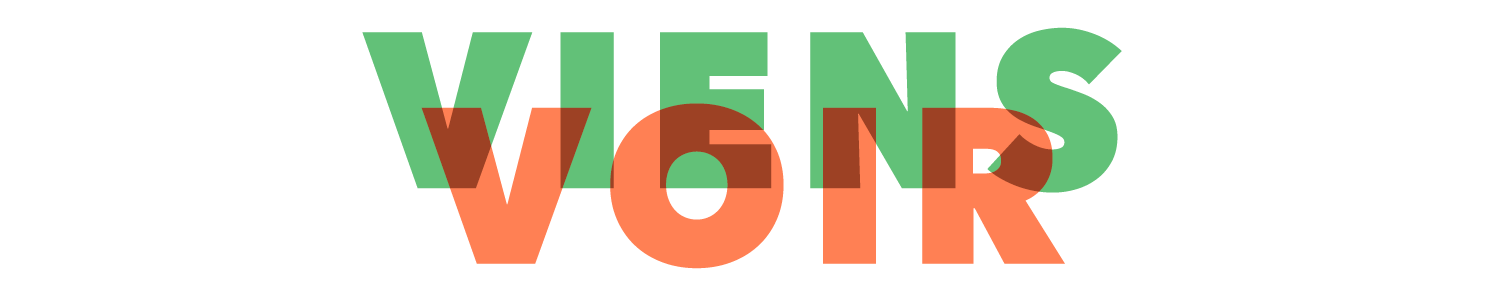Peu de photos exercent sur nous une réelle fascination. Une fascination qu’on ne s’explique pas vraiment, mais qui ne cesse de nous interroger. Une image sur laquelle on reviendrait inlassablement. À l’instar du rapport qu’entretenait Georges Bataille avec la photo du supplice chinois dit des cent morceaux. Ces photos, combien sont-elles ? Et à quoi font-elles appel en nous ?
J’ai trouvé cette image. À chaque fois qu’elle tombe sous mes yeux, je ressens que sa puissance est intacte, à tel point qu’il m’est difficile de démêler le sujet de la photo de la force narrative qu’elle déploie. Cette photo, prise par la photographe sicilienne Letizia Battaglia, représente le juge Roberto Scarpinato et son escorte, pendant le procès de l’ancien Président du Conseil italien, Giulio Andreotti, en 1998.
Commençons par poser le tableau.
La photographe : Letizia Battaglia (née à Palerme en 1935) est une légende de la photographie. Ses clichés dépeignent une Sicile sans fard, aussi bien celle des rues que de la campagne et des palais. Surtout, elle a photographié les crimes de la mafia et s’est engagée contre elle, à la fois comme conseillère municipale et comme instigatrice de mouvements de protestation de femmes contre ce fléau.
Le juge : Roberto Scarpinato est surnommé le dernier des juges*, puisqu’il a fait partie du pool anti-mafia. Dernier parce qu’il est le dernier survivant après les attentats mafieux de 1992 qui ont tué les juges Falcone et Borsellino. Depuis, il a instruit les plus importants procès anti-mafia. Voilà 25 ans qu’il vit en permanence sous escorte policière.
La mafia n’a rien de folklorique
La fascination d’une image prend nécessairement une voie autobiographique. J’entretiens une relation très intime avec certains lieux de Sicile. Pas seulement celle de moments de bonheurs familiaux ou touristiques. Mais la relation poignante qu’on peut avoir avec certaines topographies, certains lieux chargés d’histoire (le site phénicien de Solunto), certaines sensations de plénitude que je ne pourrais décrire qu’avec une emphase un peu ridicule.
Mais dès qu’il est question de la Sicile, la mafia vient à l’esprit. Or, si elle est partie intégrante de l’histoire de la Sicile, la mafia n’a rien de folklorique : elle pèse sur le passé comme sur le présent. Il ne faut pas être dupe de la mythologie qui s’est développée autour d’elle. Celle-ci ne saurait masquer le fond de criminalité, de terrorisme, de corruption et d’intérêts financiers sur lesquels la mafia prend appui. Il faut encore moins se laisser abuser par le concept d’honneur presque chevaleresque qui lui est accolé (les mafieux s’appellent entre eux les hommes d’honneur) : quel honneur y a-t-il à planifier attentats et exécutions pour servir des intérêts privés ? À asservir la population sous une loi occulte et inégalitaire ?

Et maintenant, la charge de la photo. Avant de croiser le regard du juge, ce que je vois, ce sont ces quatre hommes qui portent tous un revolver, pointé vers le sol mais bien visible. Ils n’ont pas d’uniforme, mais des vêtements quotidiens, presque de vacanciers. Leurs regards créent des faisceaux divergents hors-image. Ils couvrent l’environnement, prêts à répondre ou à mettre en joue. Menace latente, violence retenue. Au milieu d’eux, un homme en costume fixe l’objectif, une cigarette entre les doigts. Regard direct sous un franc soleil. Derrière eux, la montagne, quelques nuages, arrière-fond typiquement sicilien. Les hommes aux revolvers sont presque tous bien campés, les jambes écartées, prêts à réagir. Celui au costume est légèrement déhanché, il n’a pas les mêmes préoccupations.
Si l’on ne disposait pas du contexte, qu’est-ce qui permettrait de dire que ces hommes sont du côté de la justice et non de l’autre ?
Le piège de l’identité des signes
Voilà ce que cette image m’a permis de comprendre : le piège que constitue l’identité des signes. Mais s’il ne s’agissait que du piège visuel qui menace le spectateur, la problématique serait finalement assez classique. Ce qui se révèle ici, c’est que le piège est aussi celui de la réalité-même : la mafia force ceux qui la combattent à entrer dans certains de ses codes (par exemple, ici, des gardes du corps prêts à se sacrifier pour un seul homme). Comme si le mal nous soumettait à ses lois, nous forçait à adopter ses méthodes. Voilà la vérité sidérante qui se dégage de cette photo : il ne suffit pas que la mafia apporte ses contraintes, elle nous extrait doublement de la civilisation. Par sa loi perverse qu’elle inocule dans la vie politique, mais aussi parce qu’elle lui impose son fonctionnement archaïque.
Certes, le visuel ne trace pas de frontière. Mais le contenu de cette photo est, lui, sans ambiguité : celui que protègent ces hommes est un juste, un de ceux qui résistent pour que les armes tombent. Pour que chacun retrouve et cultive la capacité de tomber amoureux de la destinée des autres**.
Lire les propos de Roberto Scarpinato, c’est s’interroger de manière radicale sur la nature humaine, la responsabilité individuelle et collective, le bien et le mal. C’est une leçon de philosophie autant qu’une leçon de politique.
*Titre du livre d’entretien de Roberto Scarpinato avec Anna Rizello, éditions La Contre Allée, un concentré de citoyenneté pour 7€ : lecture d’autant plus obligatoire que Letizia Battaglia y raconte l’histoire de cette photo.
**Extrait du discours de Roberto Scarpinato prononcé le 19 juillet 2012 en hommage à Paolo Borsellino, vingt après son assassinat (cité par Edwy Plenel dans sa préface au Retour du Prince, éditions La Contre Allée).