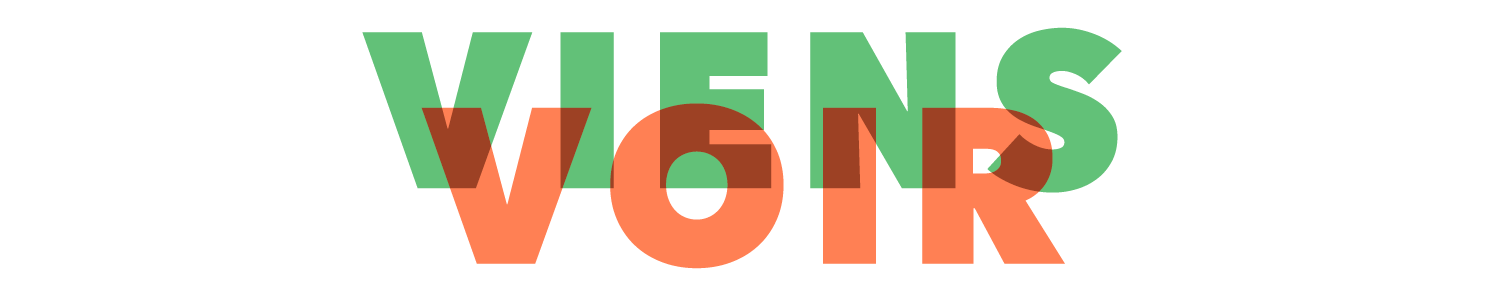Une chronique d’Isabelle Mangou. Lucie Planty est une artiste-iconographe (voir le livre de Garance Chabert et Aurélien Mole paru aux Editions Empire en 2018). Elle travaille avec les images, les triture et les transforme jusqu’à ce qu’elles expriment leurs dimensions cachées. Des photographies à voir et à manger.
Les images et leur original
Les images, les photographies, apparaissent parfois comme des mirages. La réalité qu’elles évoquent peut être opaque ou inaccessible. Si bien que, quand nous contemplons une image, nous avons du mal à ne pas établir avec elle une relation plus ou moins intense de croyance en un original dont elle serait issue. Le succès de cette croyance est largement utilisé par les images de presse, de publicité, ou de propagande qui induisent qu’il y a un original parfaitement crédible et fixé pour tous. C’est ainsi, nous nous laissons facilement duper.
Alors pourquoi cette frange brumeuse d’opacité dans une photographie? Dès les temps très anciens, on « tirait » une image de la matière-même. L’image devait donner l’impression de sortir par elle-même des profondeurs rocheuses. Elles étaient soigneusement choisies et disposées dans des espaces d’accès difficiles ou labyrinthiques.
L’original réside donc plus dans l’activité obscure de la matière et de sa métamorphose. Il est alors difficile de parler d’un original, tel qu’on l’entend actuellement.
En ce sens, les artistes actuels, et en premier lieu les photographes, continuent à générer de cette manière leur création, à en déployer l’élan vital, que ce soit dans un portrait, un paysage ou une scène de rue. En partant d’une feuille enduite de sels d’agent ou d’autres matières diverses ou même de pixels, ils élargissent l’inconnu. Des horizons exploratoires nouveaux se déploient.

Lucie Planty et les archives
Lucie Planty, est une artiste qui travaille intensément sur la question de l’archive et de la mémoire, sur sa matière disparaissante et renaissante. Que toute image soit une hantise, ou le fantôme d’un original introuvable, que l’histoire soit amnésique d’elle-même lui est familier.
Il y a une sorte de magie à rencontrer une artiste qui exerce une grande fluidité dans ses pratiques artistiques, sa réflexion, ses modes d’existence, et concrétise ainsi une ouverture constante aux autres. C’est le coeur de son travail. Outre de nombreuses expositions, installations artistiques et de livres, elle est aussi créatrice et animatrice de la plateforme d’artistes in.plano, commissaire indépendante d’expositions, enseignante, productrice radio, voyageuse, collectionneuse et compilatrice intensive d’images, manieuse audacieuse de mémoires, de leurs disparitions, de leurs réapparitions au cours de l’histoire visuelle (voir son site en fin d’article).
Notre rencontre est conforme à sa démarche artistique. Une conversation se crée, les références se croisent, de nouveaux récits se construisent. Ce mode opératoire de dialogue n’a rien d’étonnant chez cette artiste qui laissera toujours à l’autre une latitude pour l’action, pour la réflexion, pour des gestes neufs.

Dans l’oeuvre Siècle dernier, 100 feuillets ont été prélevés parmi le choix d’une tranche temporelle de 100 ans dans les archives numérisées du journal La Stampa. Elle les sélectionne et les présente dans une configuration de mur vertical, sans leur texte et dans l’état de dégradation des images corrompues par le passage des scanners et la numérisation.
Les originaux numérisés des photos de La Stampa sont certes totalement dégradés mais ils n’ont pas totalement disparu. Le visuel de cette oeuvre repose maintenant sur une relation circulante avec les visiteurs. Elle ne conforte donc pas une capture passive du regard du visiteur. Si toutes ces images de presse, censées nous informer visuellement au jour le jour, sont effacées, détériorées, elles nous sont, dans le moment présent de la visite, restituées et cette altération devient notre affaire à tous. ( cf. Restitutions, Georges Didi-Huberman p. 277 in « Penser l’image. Ed. Emmanuel Alloa ». Les presses du réel.)
La prise de décision vis à vis de l’oeuvre appartient à chacun. J’aime bien cette liberté donnée. Ce qui m’intéresse, c’est qu’il y a différents chemins qui peuvent amener un travail et qui permettent de rencontrer différentes personnes. En fait, ce que les gens amènent est toujours intéressant. J’aime bien quand ça incite quelqu’un à produire quelque chose d’autre, que ça renvoie à des histoires qu’ils génèreront à leur manière et qui leur seront personnelles.
Dans une autre de ses oeuvres, Images d’histoires, des meubles d’archives sont emplis de documents visuels grisés et assombris pour que les visiteurs les sortent eux-mêmes de l’ombre de ce classement faussement muséal ou faussement bibliothécaire. Ils font leur editing sur un mur, selon leur propre combinaison narrative.
Ou bien, autre installation, une fausse table de travail, nommée Le bureau de l’historien(ne), accueille des dizaines de livrets, tous différents. Les images y sont charbonneuses, comme brûlées ou en cendres. Le visiteur inventera ses propres recherches en cours ou à venir. L’artiste dépose ainsi sur ce « bureau » la sensation ressentie lors de toute recherche dans les archives livresques ou bien archéologiques, qui est celle d’une plongée dans la nuit du savoir. Lucie Planty crée des subterfuges artistiques poétiques d’une grande beauté pour déjouer l’autorité bien intimidante du « bureau de l’historien(ne) ».
Une autre oeuvre présente des manuels d’apprentissages et des brochures de disciplines artisanales, qui nous sont devenues maintenant inconnues. Leur pertinence est effacée par le temps. Elles étaient pourtant à l’époque des modèles à suivre, des opuscules indispensables. Parce que privées volontairement de contexte par l’artiste, et installées selon un magnifique dispositif, elles retrouveront aujourd’hui, malgré le décalage temporel, un public inattendu.

La démarche se déclinera et n’en restera donc pas là. Larousse publie en 1986, une sorte d’encyclopédie généraliste d’histoire. Dans Chronique de l’humanité, Lucie Planty prélève les images en enlevant tous les textes. Elle les installe dans une table lumineuse qu’on peut scroller. Visages sans légendes, guerres sans dates, tableaux sans auteurs, ça défile jusqu’à ce que certaines personnes arrêtent leur geste. A certains moments, elles reconnaissent des images qui font partie du savoir de leur enfance. Elles sont alors pour un bref instant avec « leurs » images et « leurs » rêves invisibles. Restitution encore.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
L’histoire se prolongera lorsque des visiteurs trouveront dans l’échange une manière alternative pour regarder et utiliser les oeuvres exposées. Ils attribueront alors aux images une nouvelle aura, laquelle avait disparu avec l’usure du temps, mais aussi du fait de la maltraitance des images par des machines brutales.
Réinventer ce qui a disparu, créer du faux
D’autres aventures visuelles se révèleront encore plus audacieuses. Ces oeuvres sont souvent issues d’enquêtes historiennes et visuelles longues de plusieurs années. Elles nous entrainent dans le labyrinthe des disparitions.
Parmi tant d’autres, l’une d’elles, particulièrement émouvante, est La collection particulière. C’est un travail de recherche sur les oeuvres spoliées dans les territoires occupés par l’armée allemande, pendant la seconde guerre mondiale. Elles ne furent jamais retrouvées. Il ne reste que quelques traces infimes au dos de fiches d’inventaires, quelques très vagues indications, quelques mauvaises photos en noir et blanc. Aidée par un restaurateur qui a aussi la qualification d’être un copiste réputé, Philippe Dutilleul (nom d’artiste : Philippe Van der Linden), ils inventent ensemble une reconstitution fictive en couleur des oeuvres perdues. Une fausse copie des tableaux est réalisée, entre réel, hallucination et documentation. Mais pourquoi faire appel à un copiste ?
Notons que la tradition des copistes est très ancienne. Pour démystifier la désorientation, voire le découragement des chercheurs concernant la diversité des inventions des copistes quand ils exécutent leurs copies, le philologue et médiéviste Michel Zink en clarifie les raisons. Dans son domaine, le Moyen Âge, les parchemins sont forcément mouvants, forcément incertains, forcément « faux ». Les distorsions peuvent être considérables, et les originaux introuvables. Toutes les écritures, avant l’imprimerie, ne sont jamais sûres. Les processus d’altérations volontaires n’avaient rien d’anormal. Elles n’étaient pas considérées comme fautives par rapport à l’original. Certains copistes recopiaient en s’inspirant d’autres ouvrages. Il y avait alors plus des autres ouvrages que du travail de copie lui-même. D’autres copiaient en commentant si brillamment qu’on ne pouvait plus distinguer le commentaire du texte. Enfin d’autres encore copiaient en mettant tellement d’eux-mêmes qu’ils devenaient, malgré eux, les quasi seuls auteurs du manuscrit d’origine qui aurait dû être fidèlement recopié.
L’original peut ainsi disparaitre, en quelque sorte, un nombre incalculable de fois. Et bien sûr pour complexifier la recherche, toutes ces versions étaient souvent éparpillées au 4 coins de l’Europe ou du monde. Lucie Planty réutilise donc une très ancienne méthode pour copier/inventer un original en partant des infimes indices en sa possession. Elle conserve ainsi une trace toujours active, toujours vivante de cette mémoire qui a été si brutalement spoliée.

Disparition par cannibalisme de l’image
Cette oeuvre est tellement étonnante, déstabilisante et belle que son histoire vaut la peine d’être racontée. La narration ne sera donc pas un fait surprenant, car tout son travail provoque du récit qui se décollera comme une peau de la matière dont il est originaire.
Cette installation a été présentée en 2023 dans une exposition à Paris, à La Ruche, rassemblant plusieurs artistes. Celle-ci était intitulée « Le monde comme image », curateurs Bruno Dubreuil et Bogdan Pavlovic.
Lucie Planty dispose sur un présentoir longitudinal, fixé au mur, de très nombreuses photos en noir et blanc qu’elle a miniaturisées. Bien rangées comme dans une mini bibliothèque, elles sont offertes au public pour qu’il les mange. Une petite enveloppe en plastique transparente, dont on doit se débarrasser avant d’ingérer, protégeait les photographies.

L’artiste a collecté des photos jetées dans la rue. Elles étaient destinées à la benne. Elle a sélectionné les photographies, les a photographiées et miniaturisées. Elle les a ensuite faites imprimer sur du papier azyme comestible par un spécialiste. Enfin, elle a rendu les originaux à leur destin initial : la disparition. Elles auront ainsi doublement disparu, une fois par le destin de la benne, puis par nous-mêmes. L’ingestion se fait consciemment. Le geste intervient dans un contexte public, ritualisé par le dispositif de l’exposition.
Donc dévorées sur place….ou pas. En ce qui me concerne, j’ai pris une petite poignée de photos et j’en ai choisi deux. J’ai remis les autres dans la « photothèque à manger ». Je les ai emportées et tel un écureuil, je les ai si bien rangées chez moi que je les ai perdues. Puis, finalement, je les ai retrouvées.
Je lui demande l’origine de cette idée. Elle m’explique qu’elle a été, pendant la période du confinement, à la fois co-commissaire, avec Alexandra Goullier-Lhomme, et participante, d’une exposition postée. Des personnes s’abonnaient à une plateforme qu’elles ont créée. Une oeuvre était envoyée par la poste à chaque abonné(e), tous les mois pendant un an. Donc pour les 12 artistes du collectif d’artistes in.plano, dont elle-même, il s’agissait d’échapper aux réseaux et à internet, si intrusifs pendant cette période.
Reçues d’une manière intime, sans que le monde extérieur n’intervienne, il n’y eut pas de photographies des oeuvres envoyées, pas de documentation, pas de retour, pas de commentaires. « L’exposition » s’appelaient Date(s) et grâce à cet engagement tacite avec les abonné (e)s, ce fut comme une correspondance secrète qui se jouait entre eux.
Sa propre oeuvre envoyée était accompagnée de la seule légende : « Oeuvre comestible jusqu’au … (date limite de consommation). Nous n’en saurons bien sûr pas plus.

Le contexte de l’exposition était complètement privé et intime. on se retrouve alors tout seul avec soi-même. Est ce que je la mange ?
Une autre influence importante comptera beaucoup pour générer la suite et agrandir cette idée. Il s’agit de sa réflexion concernant une de ses collections personnelles d’archives, celle de photos de gâteaux d’anniversaire bien particuliers .
Cela m’a toujours fascinée les gâteaux d’anniversaire avec les photos d’enfants sur papier azyme, et qu’on va découper pour les manger. C’est un geste qui n’est pas du tout regardé. Il y a le geste de manger la photo de quelqu’un pour son anniversaire, de le consommer le jour où il a une année de plus.
On pouvait difficilement échapper alors au plaisir du partage de nos connaissances et références sur le cannibalisme dans certains travaux des anthropologues et historiens.
« Les iconophages, une histoire de l’ingestion des images », de Jérémie Koering étudie plus particulièrement la période antique, puis chrétienne. Le léchage ou l’ingestion sous forme solide ou liquide des images sacrées ou pieuses étaient considérées comme une protection efficace contre l’adversité. Et même c’était un soin, une thérapeutique considérée comme particulièrement efficiente. L’ingestion des hosties chrétiennes n’étant qu’un cas spécifique parmi d’autres.
Il y a celui des anthropologues comme Levi-Strauss dans « Nous sommes tous des cannibales ». Mais aussi à la fois des témoignages directs et des analyses après-coup comme dans « Le dernier voyage du capitaine Cook » de Heinrich Zimmermann avec les passionnantes préface et postface d’Isabelle Merle. Elle retrace le fil des évènements qui se sont conclus par le démembrement et la dévoration partielle de l’explorateur Cook par les habitants autochtones des iles hawaïennes.
Le travail des brésiliens que ce soit Eduardo Viveiros de Castro, Suely Rolnik ou Oswald de Andrade sont très présents dans les écrits actuels. Le Brésil, est considéré par ces auteurs comme une immense réserve de diversité et d’hétérogénéité, où muter en avalant l’autre est un mode de subjectivation habituel. Pour échapper et résister à une domination coloniale exclusive, on avale le dominant. Les matières mentales, corporelles, esthétiques, culturelles sont hybridées et ainsi les faits identitaires sont pulvérisés. Par un procédé d’involution créatrice, une nouvelle mutation peut s’opérer. Les particules de l’autre se mélangent et mutent de manière invisible. Processus qui n’est pas cependant sans écueils pour les dominés, comme le notera Suely Rolnik.

Comment je les ai mangées
En écrivant ce texte, j’avais à côté de moi mes deux images prélevées à l’exposition de La Ruche. Je les avais choisies car l’une représentait un homme, d’un âge moyen, chauve, avec des lunettes, en polo à manches longues, les mains enfoncées dans les poches et regardant le (la) photographe. Derrière lui un paysage champêtre était envahi d’une immense nappe de brouillard cotonneuse recouvrant tout le paysage et prête à envahir toute la photo elle-même. Elle était donc comme prise un peu dans l’urgence, car la photo était maladroite, complètement de traviole, ce qui lui donnait un aspect encore plus mystérieux. J’avais choisi la deuxième qui semblait représenter des grands bouts de bois à moitié immergés dans l’eau comme des grands totems qui auraient été fixés là et qui auraient été prêts à être submergés.
Mais, une fois chez moi, le hasard fit qu’en retournant par inadvertance cette photo, je me suis rendue compte avec stupéfaction que cela représentait une scène bien différente. Deux femmes étaient dans une forêt enneigée. Il semblait régner un froid glacial et il neigeait. Une des femmes portait un grand tronc d’arbre sur ses épaules et semblait être prise de dos. Elle s’enfonçait dans la forêt sous le regard de l’autre femme. Que faisaient ces deux femmes dans cet environnement hostile avec ce grand bout de bois sur les épaules pour l’une d’elle? Mais en regardant plus attentivement avec une loupe, je constatais que les pieds de la femme était tournés vers le (la) photographe, et que ce que je prenais pour un tronc d’arbre enneigé était une altération de la photo, car sa main ne le tenait pas et qu’il se prolongeait vers la gauche dans le vide. Sur la gauche je distinguais un bout de bâtiment en dur, assez haut. En fait cette femme faisait un geste de salut au photographe. Ce que mon imagination, qui s’était emballée, avait pris pour une scène poignante, peut-être un terrible goulag…était en fait bien différente.
Enfin, j’ai dilué les 2 photos dans un verre d’eau où elles se sont délitées et j’ai avalé le tout. J’ai donc pris ainsi ma potion magique. Me restent tous ces récits, dont beaucoup furent partagés avec la magicienne Lucie Planty.
Le site de Lucie Planty et son Instagram.
Le site du collectif in plano
Et pour écouter l’émission de radio sur l’actu artistique animée par Lucie.