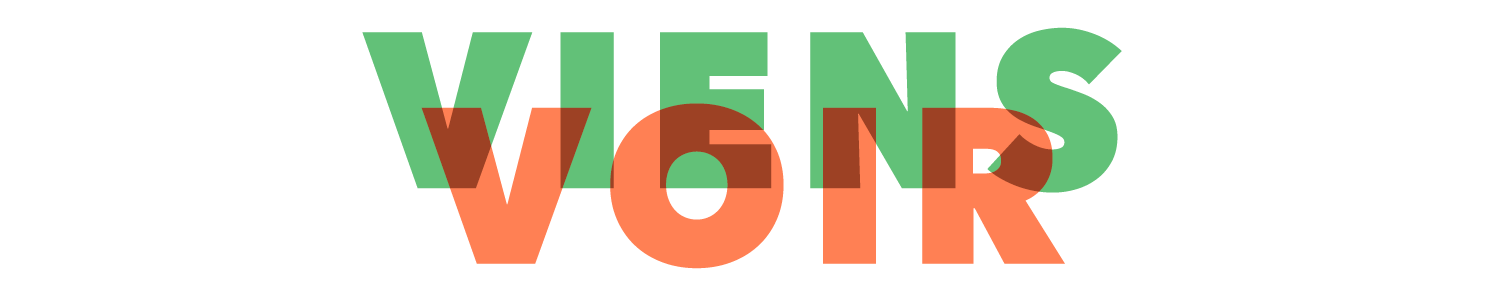Photo brute ? Pratiques photographiques à usage privé ? Fétichisme photographique ? Il y a de tout ça dans la manière dont John Kayser use de l’image et ça prolonge plusieurs réflexions que nous avons eues sur ce blog. Conversation et analyse avec le galerie Christian Berst qui présente cet ensemble à Paris Photo.
Avant-propos
il y a bien des manières d’envisager les photographies et les films de John Kayser. Si elles et ils étaient produit.es aujourd’hui, il serait difficile d’en faire la promotion tant elles s’inscrivent dans un regard masculin dont les conséquences sont quotidiennement dénoncées. Mais elles ont été imaginées et fabriquées il y a plusieurs décennies et nous parlent d’une intériorité prise dans un certain monde, à une certaine époque. Ce sont les formes de son expression que nous détaillons ici, sans volonté d’en faire l’apologie.
Les Inclassables de la photo
Appelons-les : les Inclassables, ces ensembles de photographies qui apparaissent soudainement (ou presque) et qui, jusque-là, étaient restés ignorés ou déconsidérés. Ils émergent d’une valise marchandée chez un brocanteur, de cartons ouverts à l’occasion d’une succession, parfois d’une simple poubelle d’où dépasse un album de famille. Leur auteur, quand il est identifié, n’a laissé aucune trace dans l’histoire du medium. Soudain, hors de la sphère privée, est posé sur eux un regard qui les soupèse, les réévalue et les transmute en objets esthétiques, soit une opération d’artification. Pour les théoriciens, ces Inclassables rejoindront le tiroir étiqueté photographie vernaculaire ou photo brute ou encore photo anonyme ou toute autre catégorie à inventer car il est tentant de tirer avantage de la malléabilité d’une œuvre vierge et plus ou moins déracinée. Pourtant, la plupart de ces ensembles photographiques sont rétifs à la classification puisqu’ils sont des hapax. Or, justement, l’époque aime la singularité, laquelle autorise à émietter à l’infini le regard porté sur l’art d’aujourd’hui et dispense de certains approfondissements théoriques.
Surtout, ces ensembles excitent l’imagination parce qu’ils sont truffés d’angles morts contextuels qui facilitent aussi bien le fantasme que l’interprétation.
Photo brute ?
John Kayser, lui, est plutôt bien identifié. Né en 1922, il a vécu et travaillé dans une société aéronautique (ce détail n’est pas anodin par rapport à certaines images) à Los Angeles, Californie. À partir des années 60 et jusqu’aux années 90, il réalise des photographies et des films, qui n’ont été découverts qu’après sa mort en 2007. Les photos relèvent de prises de vue réalisées en extérieur ou en studio. Les modèles, recrutées parmi ses amies ou dans des bars interlopes, s’exhibent, la plupart du temps, dans des positions dévoilant plus ou moins leur corps, en prenant appui sur un objet, une matière, voire l’auteur des photos lui-même. Parmi les ensembles de photos estampillés photo brute, on peut opérer des rapprochements formels avec celui intitulé Zorro et les images de Eugene Von Bruenchenhein. Mais pour autant, cette forme de fétichisme photographique peut-elle être considérée comme relevant de la photo brute ? Car il y a un écart entre se mettre en scène en solitaire et impliquer des modèles pour figurer son monde intérieur et seulement le sien.

C’est à la suite d’un parcours tortueux que cet ensemble de plusieurs cartons de tirages papiers, pellicules non développées et bobines de film Super 8, donc fort de plusieurs milliers de photos et films (précisons qu’à Paris Photo ne seront présentés que des tirages vintage), est tombé sous le regard du galeriste Christian Berst une dizaine d’années auparavant. C’est dans son bureau, passage des Gravilliers, que nous entamons cette conversation.
Vertiges de l’interprétation
Christian Berst : A l’époque où je les ai découvertes, j’ai voulu les exposer dans la galerie que j’avais alors à New-York. Elles m’intéressaient, quoique le fétichisme était alors un sujet qui me laissait quelque peu à distance. Mais peut-être que la fréquentation d’oeuvres comme celle de Miroslav Tichý a fait évoluer mon regard et pressentir qu’il y avait là quelque chose en lien avec l’art brut. Si l’on considère que, pour reprendre le point de vue de Harald Szeeman, l’art brut est la mise en forme d’une mythologie individuelle, est-ce qu’alors ça ne correspond pas précisément à la pratique de John Kayser puisque celle-ci est sans enjeu commercial, à usage entièrement privé, et tente de donner un contour à un monde fantasmatique ? Reste la manière dont cette pratique photographique s’inscrit dans l’histoire de l’art, les liens éventuels tissés entre les deux. Cela ne me semble pas franchement établi même si, dans les modes de représentation et dans l’érotisme, il rejoint quelque chose de l’ordre d’un imaginaire relativement codifié.
Bruno Dubreuil : une question demeure en suspens. Est-ce qu’en plus du fétichisme des objets et du corps, il y avait un fétichisme de la photo en tant que support matériel ?
Tu pointes une éventuelle sacralité qu’il aurait accordé à sa production photographique : utilisait-il ses tirages dans des formes de rituels ? Sur ce point, on ne sait rien. Personnellement, j’avance un parallèle avec l’avènement de la photographie qui, dans l’atelier du peintre, a progressivement remplacé le travail avec le modèle vivant. De ce fait, la photographie accédait à un statut complètement différent. Je me suis demandé si Kayser ne se servait pas de la photographie pour ressusciter les frissons et les extases qu’il avait pu ressentir au moment où il réalisait les mises en scène avec les modèles vivants et rejouer ainsi l’émotion à l’infini. C’est la question à laquelle nous ne pouvons pas répondre : est-ce que, pour John Kayser, le moment de la prise de vue est paroxystique ou est-ce qu’il lui permet de retrouver cet état par la contemplation de la photographie, objet témoin de ce moment ? A mes yeux, tout cela concourt à nous présenter ce type de fétichiste comme quelqu’un qui essaie de créer quelque chose, disons un corpus qui constitue une voie d’accès à son propre monde.
Fétichisme et érotisme de la photographie
Ne pourrait-on pas dire aussi que Kayser, au lieu de construire quelque chose, réessaie à chaque fois parce qu’il n’arrive pas à atteindre ce qu’il vise ? C’est une lecture possible de son acte photographique.
Oui, dans ce cas, le moteur serait une forme d’insatisfaction, une quête érotique inassouvie…
Mais si la dimension performative, le moment vécu, lui suffisait, pourquoi alors prendre la photo ?
Parce que l’appareil photo rentrerait dans la médiation indispensable à sa jouissance ? C’est-à-dire qu’il se fabriquerait un voyeur, ou un autre lui-même qui, à un autre moment, reconsidèrerait la situation… C’est ce vertige des possibilités qui nous interroge le plus. Avec le fait que la dimension itérative, scopique peut produire une forme de fascination.
Selon toi, quel est le fil qui relie ces photographies ?
Ce qui s’impose, c’est le contact d’une partie érotisée (fesses, pied) avec une autre partie plus ou moins incongrue. Cela peut être sa propre tête, ce qui relève d’un schéma érotique plutôt traditionnel, mais c’est parfois beaucoup plus inattendu : un gâteau, une tête de bouddha, un avion miniature. On peut considérer alors que Kayser se libère d’une mythologie collective et donc, sa pratique prend une autre portée. Je me souviens très bien des circonstance dans lesquelles j’ai découvert ces images, près de Stanford, il y a dix ans. J’étais dans une pièce, avec une chaleur étouffante, j’ai passé deux jours à regarder ces images et je dois dire qu’à un moment donné, toute dimension érotique a disparu.

Autopsie de l’ensemble
de photographies
Détailler la sélection présentée à Paris Photo (rappelons qu’il s’agit de moins d’une centaine de photos choisie parmi plusieurs milliers) laisse affleurer de nouvelles questions. Si certaines images sont très crues (un sexe féminin en contact avec un club sandwich en arbore encore quelques miettes), d’autres sont des poses en extérieur en rapport avec des poses académiques de la statuaire et de la peinture. Il est difficile de se prononcer sur le degré de perfectionnement technique de leur auteur. Certes, il est bien équipé en matériel puisqu’il dispose de plusieurs fonds photos (certains peints par lui-même ?) et d’éclairages de studio, mais il n’est pas ce qu’on appelle un technicien accompli. C’est que l’enjeu ne réside probablement pas dans la technique.
Quelques photos donnent des indices sur l’appartement de l’auteur et, sur l’une d’elle, d’autres photos de nu sont punaisées sur le mur. Il y a aussi des fusains de sa main dont un autoportrait qui subira bien des dommages sous le talon aiguille.
Plutôt que voir dans ces images des références explicites à des classiques de l’histoire de l’art (La femme qui pisse de Rembrandt ou La Venus d’Urbino de Titien), il me semble que cette photographie s’inscrit dans des archétypes de genre (nature morte, portrait costumé) avec certains écarts par rapport à cette norme.
Nous serons attentif à des détails porteurs de touches personnelles : l’utilisation du miroir à main dont la partie centrale est parfois évidée. Ne reste alors que l’armature sans fonction, incapable de retourner le reflet du modèle. Que peut-on bien chercher dans un miroir que l’oeil pourrait traverser ?
Autre touche personnelle, la notion de socle qui a aussi toute son importance, même si celui-ci est bien souvent dérisoire ou franchement inapproprié (caquelon, citrouille, guitare). S’agit-il d’immortaliser ou de pétrifier le modèle ? Ou au contraire de moquer une certaine théâtralité ? Il est à noter que cette dérision se prolonge dans les images dans lesquelles les modèles rient avec (ou de ?) leur auteur.
Certaines bizarreries se rapprocheraient-elles d’une forme d’élaboration ? Ainsi le sexe de la femme recouvrant les yeux de la dépouille d’un ours polaire tandis que la gueule ouverte de l’animal ouvre ses crocs vers le photographe ; ou bien deux pieds nus féminins foulant la page d’un album photo, recouvrant à moitié deux portraits, peut-être ceux de l’auteur ; ou encore, dans un cadrage fragmentaire d’une modernité saisissante, John Kayser simule son double écrasement, à la fois sous une voiture dont le bas de caisse est accidenté et sous une jambe. L’ombre portée de celle-ci nous indique que c’est probablement celle d’une femme dont la main repose sur la portière.
Un dernier point : comment penser la place des poses en extérieur de modèles habillés ? Etaient-elles aussi signifiantes que les poses en atelier ? Etaient-elles une répétition de la nudité qui pourrait ensuite se photographier en intérieur ? Ou bien l’imagination de Kayser faisait-elle que, bien qu’habillées, ces femmes lui apparaissaient déjà nues ?
Enfin, s’ajoutent aux photographies de nombreux films super 8 qui dévoilent d’autres aspects. Ainsi élargissent-ils le spectre de ces images, depuis la mise en scène de ces femmes dans un simulacre de vie quotidienne jusqu’à la pornographie explicite. Ils prolongent aussi certains gestes. Ainsi, celui du piétinement, motif récurrent de plusieurs photographies. Un pied féminin s’acharne jusqu’à l’effacement d’un portrait au fusain du photographe. Un autre pied détruit obstinément un modèle réduit de voiture.
Le mystère de ces images reste entier, avec son pouvoir attractif ou répulsif.

BD : Tu classerais cet ensemble dans la photo brute ?
CB : J’ai envie de continuer à poser la question du fétichisme dans la sphère de l’art brut, qui en est une forme d’extension. Quand on considère la nature de ce qu’on peut voir dans une exposition de photos brutes, il y a beaucoup d’images traduisant la répétition d’une obsession jusqu’à l’épuisement. L’auteur essaie de resserrer la focale sur un détail et le creuse jusqu’au vertige.
Entre fascination et répulsion
Arrives-tu à expliquer la fascination, la répulsion ou la réprobation qu’on peut éprouver pour ces images ?
On constate qu’elles peuvent profondément nous perturber. Cette instabilité psychique est un terreau fertile pour convoquer quelque chose de principiel en soi. Pour nous qui sommes relativement bien structurés, ce qui nous permet de ne pas sombrer, on peut prendre ces singularités avec soi : comprendre sans se faire prendre. Une sorte d’émoi devant le plus nu de la vie et je crois que, à travers ce type de prise de conscience, on s’approche, osons le dire, d’une forme de vérité de cette personne.
Enfin, comment perçois-tu la position de ces images à Paris Photo ?
Je pense que c’est une singularité inattendue, presque nécessaire, un élément de perturbation qu’on peut accueillir favorablement par rapport au périmètre de la photographie. Le nu bourgeois, sous des formes diverses plutôt conventionnelles, mais adoubé par l’histoire de l’art, y est partout présent. Mon ambition, c’est que l’on puisse regarder ces images avec le recu lnécessaire, dans le contexte de l’époque, sans que l’on puisse oublier que ça puisse aussi relever d’un jeu entre le photographes et les modèles. Par ailleurs, que serait l’art sans transgression ?
Le site de la galerie christian berst art brut