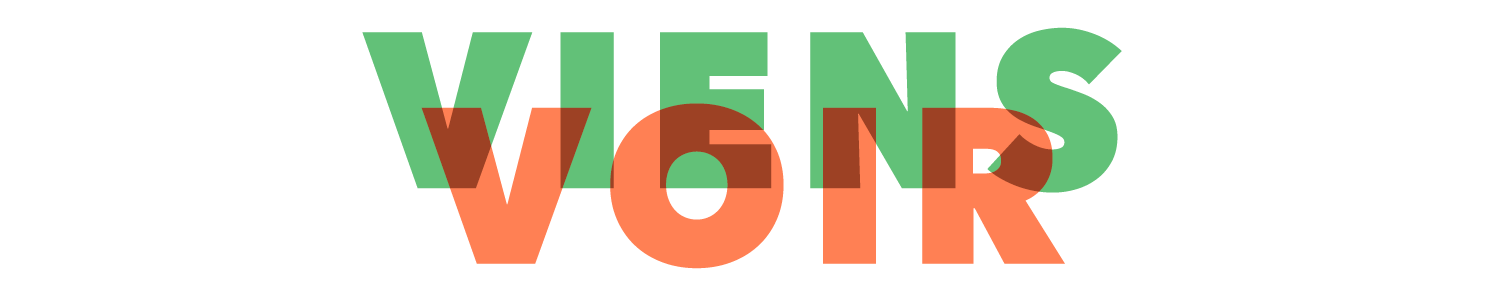Notre chroniqueuse Silvy Crespo est partie à la rencontre du nouveau lauréat de la Résidence BMW, Émeric Lhuisset : plongée dans la démarche créative d’un artiste aussi entier que singulier.
English version included below
Juillet 2018.
Ce jour là, pas un seul nuage n’obscurcit le ciel bleu arlésien. Je suis arrivée la veille et déjà la chaleur a raison de moi, et de mon déodorant. Je n’ai qu’une envie : me mettre au frais en sirotant du rosé, mais à défaut de pouvoir m’adonner pleinement à un farniente intensif, je chasse l’ombre.
Aussi, lorsque votre bookista préférée, Olenka, me propose une virée chez Monoprix pour faire les soldes et, accessoirement, découvrir les livres sélectionnés pour les prix Livre de l’Année et Luma Dummy Book Award, j’accepte.
Sur place, l’air est lourd et la quantité de livres alignés en rang d’oignons me donne le vertige. Je me réfugie donc dans un ouvrage que j’aime*, histoire de retrouver un peu de plaisir à être là. Je suis absorbée dans ma lecture quand je crois entendre une voix.
Oui, une personne s’adresse à moi et m’interroge sur le livre que je tiens entre mes mains. Erreur fatale ; je suis une grande bavarde. Mais cela n’a pas l’air de déranger mon interlocuteur, lequel me recommande au passage de passer une tête à l’exposition « Grozny : neuf villes » montrant l’œuvre collective des trois photographes Olga Kravets, Maria Morina et Oksana Yushko**.
Nous finissons tout de même par nous présenter et j’apprends que la personne qui se tient en face de moi n’est autre qu’Emeric Lhuisset, lauréat de la résidence BMW 2018 et dont je connaissais certaines images de la série « Théâtre de guerre », réalisée en Irak.
Le jour même, je propose à Emeric de le rencontrer dans son atelier parisien pour prolonger notre conversation et en savoir un peu plus sur ce Jack Bauer de la photo. Une semaine plus tard, me voilà donc, de bon matin, à la porte de son antre, doigt pressé sur le bouton d’interphone, décidée à le faire parler.

Mais commençons par le commencement.
Emeric, qui est diplômé de l’Ecole des Beaux Arts de Paris et de l’Ecole Normale Supérieure Ulm – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est un artiste plasticien dont le travail aborde essentiellement des problématiques géopolitiques.
Comme il se plait à l’indiquer, sa démarche se veut avant tout anthropologique. A la manière d’un chercheur, il va dans un premier temps « produire un travail de recherche théorique qui consiste à lire des ouvrages sur le sujet, à rencontrer des chercheurs spécialisés dans le domaine abordé et à faire du suivi presse ».
Dans un deuxième temps, lorsqu’il commence à avoir une bonne connaissance théorique de son sujet, il va faire un travail d’enquête de terrain, directement auprès de personnes concernées, afin de tenter de visualiser ce qui les a conduites à une situation donnée. Il s’agit pour lui de comprendre « à quoi ressemble leur quotidien », ainsi que de « connaître leurs aspirations ». Ce n’est qu’une fois ces deux étapes accomplies, et uniquement s’il « pense avoir un regard pertinent » qu’il va produire une œuvre qui sera la retranscription plastique de cette analyse.
Bien qu’il ait réalisé quelques projets en Europe, notamment en Ukraine, et en Amérique Latine, sa zone géographique de prédilection demeure le Moyen-Orient.
Pourquoi le Moyen-Orient ?
J’ai commencé au Moyen Orient parce qu’au tout début de ma carrière d’artiste je n’avais pas d’autres ressources que le RSA (Revenu de Solidarité Active). Je m’intéressais à des questions de géopolitique. Or, il s’avère que le Moyen-Orient est une zone particulièrement riche au niveau géopolitique et en même temps, il est facile de s’y rendre. Un Paris-Istanbul, hors saison, ne coûte pas cher et le reste du voyage s’effectue en bus. Je prenais donc le bus pour l’Irak ce qui me permettait d’aller sur le terrain sans avoir d’argent. A force de travailler dans la région, j’y ai tissé tout un réseau et je m’y suis fait beaucoup d’amis. Au fur et à mesure, il s’est passé de plus en plus de choses et du coup, j’ai continué à travailler là-bas. Mais je ne travaille pas que là-bas. J’ai aussi fait d’autres projets dans d’autres endroits, en France, en Ukraine. J’ai travaillé un petit peu en Amérique du Sud. Mais c’est vrai que le Moyen-Orient c’est une zone que j’aborde plus particulièrement.
Le Moyen-Orient nous est présenté comme une zone dangereuse. N’as tu pas éprouvé, à un moment ou à un autre, des appréhensions ?
Cela fait maintenant quinze ans que je travaille dans cette région qui m’est désormais familière. Je n’ai plus du tout de difficultés. J’ai réussi à passer outre les stéréotypes et les clichés que je pouvais avoir nourris en grandissant en banlieue parisienne au contact de mes copains, dont beaucoup appartenaient à la diaspora Nord-Africaine, Algérie, Tunisie, Maroc. Ma grand-mère elle-même a vécu un certain temps en Tunisie, notamment pendant la guerre puisqu’elle avait quitté la France au moment où les allemands sont entrés sur le territoire français. J’étais donc déjà plutôt sensible à la « culture arabe », même si, honnêtement, je n’en connaissais pas grand chose.
C’est vrai que les tous premiers projets que j’ai faits, je les ai souvent faits de manière maladroite. J’avais vingt ans, j’étais encore très jeune, très méconnaissant et maladroit. Mais j’avais la volonté de découvrir et de comprendre. D’ailleurs, j’ai produit assez peu de choses, j’ai surtout essayé de comprendre, de voir. C’est encore le cas aujourd’hui. Quand je suis sur le terrain, je passe énormément de temps et je produis peu globalement.
Il m’arrive fréquemment de passer plusieurs mois, de ne faire aucune image, de revenir en France et puis de repartir, de repasser du temps, peut-être produire une ou deux images, puis revenir. Et c’est en ce sens là aussi que je parle d’une approche anthropologique et non pas journalistique parce que je n’ai pas derrière moi un journal qui sollicite de ma part un certain type d’images. J’ai le luxe d’avoir le temps pour moi et le temps de comprendre, de réfléchir sur ce que je peux avoir à dire, le luxe de ne rien dire si je pense que je n’ai rien d’intéressant à dire.
C’est exceptionnel d’entendre ça. Es-tu conscient qu’à l’heure ou le milieu de l’art, et le milieu de la photo notamment, est un peu devenu comme l’industrie de la mode, avec des cycles de production, comme les concours par exemple, comment le vis-tu ? Car certains ont du mal à se détacher de cette pression grandissante vis à vis de l’artiste et du photographe pour produire constamment ?
Je suis assez détaché de tout ça. Les concours j’en fait aussi. Si l’un de mes projets peut correspondre à l’objet de l’un de ces concours tant mieux. Si j’ai choisi d’être artiste c’est parce que c’est à mon sens ce qui m’offre le plus de liberté. Pour moi c’est quelque chose d’essentiel : c’est pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et prendre le temps de faire ce que je fais.
Si je n’avais pas le temps pour moi, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Ce sont des projets qui nécessitent un degré d’investissement, de confiance et d’intimité des gens avec lesquels je travaille qui ne pourraient pas se faire en trois semaines. Je prends mon temps et je trouve que c’est bien de prendre son temps. Cela donne du recul par rapport à son propre travail et puis cela permet de faire vivre chaque projet, de le penser non seulement en-dedans, dans le cadre d’un espace d’exposition, mais aussi en dehors, dans l’espace public qui devient alors espace d’intervention. J’aime bien réfléchir et penser à la meilleure manière de montrer mes projets.
J’ai affiché dans l’espace public en Colombie et en Irak. Pour ce dernier projet, « J’entends sonner les cloches de ma mort », qui est une installation en hommage à Sardasht Osman, les photographies ont été tirées sur papier salé non fixé et collées dans l’espace urbain, disparaissant progressivement à la lumière du soleil.

En 2010, lorsque j’étais en Irak, j’étais logé sur le campus de l’université de Salahaddin et quelques jours après mon arrivée, l’un des étudiants a été kidnappé juste devant l’université. Il se trouve que j’étais le seul occidental. Pas mal d’amis de cet étudiant sont venus me voir et m’ont pris à témoin. Ils m’ont dit que Sardasht écrivait des articles dans lesquels il dénonçait la corruption dans le pouvoir local, raison pour laquelle il a été kidnappé. Ils m’ont montré son dernier article intitulé « J’entends sonner les cloches de ma mort » et dans cet article il explique qu’il a reçu des menaces de mort et que s’il continue à écrire il sera tué, mais qu’il ne va pas fuir, il ne va pas arrêter d’écrire et il est prêt à affronter ses bourreaux et il espère que sa mort aidera à défendre ses idées. Quelques jours plus tard son corps a été retrouvé dans la rue. Il avait été exécuté.
J’ai voulu lui rendre hommage parce que c’était la moindre des choses que je puisse faire face à cette situation. Pour cette raison, ses amis m’ont introduit auprès de sa famille. J’ai passé pas mal de temps avec son grand frère. Ils m’ont donné beaucoup d’images et de vidéos de Sardasht et j’ai récupéré l’une de ses photos. Je suis rentré en France. J’en ai fait des tirages sur papier salé au format A3, des tirages que je n’ai pas fixés et pour les un an de sa mort, je suis retourné en Irak. Tôt le matin, lorsqu’il faisait encore nuit, je suis allé coller son portrait dans les rues. Quand les gens sortaient, ils tombaient nez à nez avec son portrait et puis progressivement quand le soleil a commencé à se lever les images se sont mises à disparaître pour laisser place à des rectangles noirs.

Pour la série « Cent portraits de Maydan », je suis allé dans le Donbass, dans la région de Donetsk, six mois après la révolution, coller les portraits et les questionnaires des révolutionnaires de manière à ce que les gens qui sont sous l’affluence de la propagande russe voient, en dehors de toute forme de propagande, qui étaient vraiment les gens de Maydan. Là encore, on est dans un collage dans un espace public.

C’est très important pour moi. Là par exemple, on parle de collage dans l’espace public, on parle de quelque chose de physique, mais par exemple j’ai fait une vidéo en Syrie ou j’ai filmé les 24 heures de la vie d’un combattant rebel chebab et cette vidéo je la présente en temps réel.
C’est une caméra qui est fixée sur le torse du combattant. C’est un plan séquence de vingt quatre heures. Quand les gens viennent la voir à 8 heures du matin, il est 8 heures du matin pour le combattant. Avec le recul, je me suis dit que présenter cette vidéo comme ça, c’est très intéressant, mais je pense que je n’arrive pas à toucher assez de monde. Donc je vais continuer de la présenter de cette façon, mais j’ai aussi réfléchi à un autre moyen de toucher plus de monde tout en gardant l’essence du projet qui est cette idée d’un quotidien, de quelque chose de très long. Je me suis saisi de la plateforme Instagram ; tous les jours je fais une capture d’écran d’une minute de la vie de ce combattant que je poste en temps réel.

camera subjective, 24h en boucle diffusé en temps réel, Province d’Alep et d’Idlib (Syrie), août 2012
Je me suis donc lancé dans un projet de quatre ans. Cela va correspondre à 2440 images, mais je trouve que c’est un moyen intéressant de montrer le projet. Comment montrer ? Comment donner à voir ? Ces questions sont pour moi aussi importantes que le contenu du travail lui même.
Fin de la première partie
*Le livre : « Setting The Stage : North Korea » by Eddo Hartmann, Hannibal Publishing
** « Grozny : Nine Cities » by Olga Kravets, Maria Morina et Oksana Yushko
***Pour plus d’infos sur Emeric, c’est par ici.
Instagram : @emericlhuisset
Silvy Crespo est passionnée par la photographie, l’architecture et les chats. Pour ViensVoir, elle ira dénicher des coups de cœur photographiques aux quatre coins de l’Europe (et même encore plus loin).
English version
Waiting for the clouds to speak
(Part 1)
Our editor Silvy Crespo went to meet the new BMW Residence winner, Émeric Lhuisset: immersed in the creative process of an artist as whole as he is unique.
July 2018.
That day, not a single cloud darkens the Arlesian blue sky. I arrived the day before and the heat is already killing me and my deodorant. I only want to stay cool and sip rosé, but since I can’t fully indulge in intensive idleness, I try to look for the shade.
So, when your favorite bookista, Olenka, offers me to go to Monoprix to do the sales and, incidentally, discover the books selected for the Book of the Year and Luma Dummy Book Award, I accept.
There, the air is heavy and the quantity of books lined up like a row of onions makes me dizzy. So I take refuge in a book I like*, just to enjoy being there. I am absorbed in my reading when I think I hear a voice.
Yes, a person addresses me and asks me about the book I am holding in my hands. Big mistake; I’mvery talkative. But this does not seem to bother my interlocutor, who recommends that I visit the exhibition « Grozny: nine cities » showing the collective work of the three photographers Olga Kravets, Maria Morina and Oksana Yushko**.
We finally introduce ourselves and I learn that the person standing in front of me is none other than Emeric Lhuisset, winner of the BMW 2018 residency and of whom I knew some images from the « Theatre of War » series, produced in Iraq.
The same day, I suggest to Emeric to meet him in his Parisian atelier to extend our conversation and learn a little more about this Jack Bauer of photography. A week later, here I am, early in the morning, at the door of his den, with my finger pressed on the intercom button, determined to make him talk.
But let’s start at the beginning.
Emeric, who is a graduate of the Ecole des Beaux Arts de Paris and the Ecole Normale Supérieure Ulm – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, is a visual artist whose work mainly addresses geopolitical issues.
As he likes to point out, his approach is above all anthropological. Like a researcher, he will first start to « produce theoretical research work consisting of reading books on the subject, meeting researchers specialized in the field concerned and reading the newspapers ».
After this first step, when he starts to have a good theoretical knowledge of his subject, he will do a field survey, directly with the people concerned, in order to try to visualize what led them to a given situation. He aims at understanding « what their daily lives look like », as well as « knowing their aspirations ». It is only once these two steps have been completed, and only if he « thinks he has a relevant view » that he will produce a work that will be the plastic transcription of his analysis.
Although he has carried out a few projects in Europe, notably in Ukraine and Latin America, his preferred geographical area remains the Middle East.
Why the Middle East?
I started in the Middle East because at the very beginning of my artistic career I had no other resources than the RSA (Revenu de Solidarité Active). I was interested in geopolitical issues. However, it turns out that the Middle East is a particularly rich area when it comes to geopolitics and at the same time, it is easy to get there. A Paris-Istanbul, out of season, is not expensive and the rest of the trip is by bus. So I took the bus to Iraq, which allowed me to go to the field without having any money. By working in the region, I have built up a whole network and made many friends. As time went on, more and more things happened and so I continued to work there. But I don’t just work there. I also did other projects in other places, in France and Ukraine. I worked a little bit in South America. But it is true that the Middle East is an area that I am particularly concerned about.
The Middle East is presented to us as a dangerous area. Haven’t you ever been apprehensive to work there?
I have been working in this region for fifteen years now and I am now familiar with it. I no longer have any difficulties. I managed to overcome the stereotypes and clichés that I could have nurtured by growing up in the Paris suburbs with my friends, many of whom belonged to the North African diaspora, Algeria, Tunisia, Morocco. My grandmother herself lived in Tunisia for some time, especially during the war, since she had left France when the Germans entered French territory. So I was already quite sensitive to « Arab culture », even though, honestly, I didn’t know much about it.
It is true that the very first projects I did, I often did them in a clumsy way. I was twenty years old, I was still very young, very ignorant and clumsy. But I had the will to discover and understand. Moreover, I have produced relatively few things, I have mainly tried to understand, to see. This is still the case today. When I am on the field, I spend a lot of time and produce little overall.
It often happens to me to spend several months, not to make any images, to come back to France and then to leave again, to spend time again, perhaps to produce one or two images, then to come back. And it is in this sense that I speak of an anthropological approach and not a journalistic one because I do not have behind me a newspaper that asks me for a certain type of images. I have the luxury of having the time for myself and the time to understand, to think about what I may have to say, the luxury of not saying anything if I think I have nothing interesting to say.
It’s exceptional to hear that. Are you aware that at a time when the art world, and the photography world in particular, has become a like the fashion industry, with production cycles, like competitions for example, how do you feel about it? Because some people find it difficult to detach themselves from this growing pressure on the artist and the photographer to produce constantly?
I’m pretty detached from all this. I also do contests. If one of my projects can fit into the scope of one of these competitions, great. If I have chosen to be an artist, it is because I believe it is what gives me the most freedom. For me it is something essential: it is to be able to do what I want, when I want, how I want, and take the time to do what I do.
If I didn’t have time for myself, I couldn’t do what I do. These are projects, that require a degree of commitment, trust and intimacy from the people I work with, that could not be done in three weeks. I take my time and I think it’s good to take your time. This gives perspective to one’s own work and then allows one to bring each project to life, to think about it not only inside, within the framework of an exhibition space, but also outside, in the public space which then becomes an intervention space. I like to think and reflect on the best way to show my projects.
I have pasted in the public space in Colombia and Iraq. For this last project, “I heard the first ring of my death”, which is an installation in homage to Sardasht Osman, the photographs were printed on unfixed salted paper and pasted in the urban space, gradually disappearing at the sunlight.
In 2010, when I was in Iraq, I was housed on the campus of Salahaddin University and a few days after my arrival, one of the students was kidnapped just outside the university. At that time, I was the only Westerner. A lot of friends of this student came to see me and engaged me to take action. They told me that Sardasht wrote articles in which he denounced corruption amongst local authorities, which is why he was kidnapped. They showed me his latest article entitled “I heard the first ring of my death” and in this article he explains that he has received death threats and that if he continues to write he will be killed, but that he will not run away, he will not stop writing and he is ready to face his executioners and he hopes that his death will help to defend his ideas. A few days later his body was found on the street. He had been executed.
I wanted to pay tribute to him because it was the least I could do in such a situation. For this reason, his friends introduced me to his family. I spent a lot of time with his older brother. They gave me a lot of pictures and videos of Sardasht and I took one of his pictures back. I returned to France. I made prints of them on salted paper in A3 format, prints that I didn’t fix and on the first anniversary of his death, I returned to Iraq. Early in the morning, when it was still dark, I went to paste his portrait in the streets. When people came out, they came face to face with his portrait and then gradually when the sun began to rise the images began to disappear to give way to black rectangles.
For the series « One Hundred Portraits of Maydan », I went to the Donbass, in the Donetsk region, six months after the revolution, to paste the portraits and questionnaires of the revolutionaries in such a way that people who are under the influence of Russian propaganda see, outside any form of propaganda, who the people of Maydan really were. Here again, we are in a collage in a public space.
This is very important to me. We are talking about collage in public space, we are talking about something physical, but for example I made a video in Syria in which I filmed the 24 hours of the life of a Chebab rebel and I show this video in real time.
It’s a camera that’s fixed to the fighter’s chest. It’s a twenty-four-hour sequence shot. When people come to see it at 8 a.m., it is 8 a.m. in the life of the rebel. Looking back, I thought that presenting the video like this is very interesting, but I don’t think I can reach enough people. So I will continue to present it in this way, but I have also thought about another way to reach more people while keeping the essence of the project, which is this idea of a daily life, of something very long. I used the Instagram platform; every day I take a screenshot of one minute of this rebel’s life that I post in real time.
So I embarked on a four-year project. It will correspond to 2440 images, but I find it an interesting way to show the project. How to show? How to give something to see? These questions are as important to me as the content of the work itself.