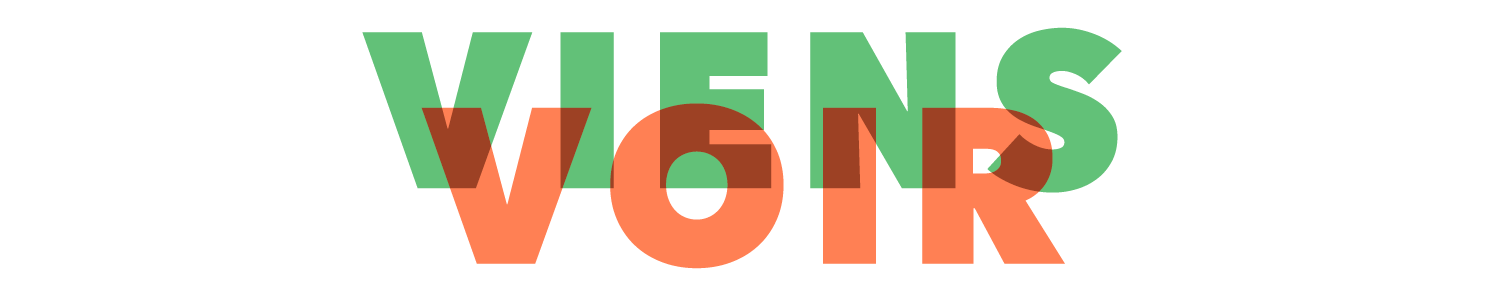Se trouver devant un chef d’oeuvre ne garantit pas que la rencontre esthétique aura lieu. Récit d’une expérience esthétique imprévue.
Je pense pouvoir dire que je connais un peu la peinture. Pas au point d’être un expert, bien sûr, mais suffisamment pour pouvoir dater le siècle auquel appartient un tableau, reconnaître les grands maîtres et même certains petits maîtres, savoir dans quelle collection se trouve tel chef-d’oeuvre, connaître un détail particulier d’une œuvre qui me permettra d’échanger avec d’autres connaisseurs. Je peux faire un détour de plusieurs dizaines de kilomètres pour aller voir une toile de Rogier Van der Weyden ou programmer un voyage dans le seul but de me tenir devant une toile du Caravage.
Mais je peux aussi bien me satisfaire de me trouver dans une capitale étrangère et ne pas visiter un musée où figurent pourtant des chefs d’oeuvre immanquables, simplement parce que la vie est longue, que d’autres occasions se représenteront. Et même si je ne devais jamais les voir, quelques regards portés sur une surface plane recouverte de traits et de pigments ne sauraient me manquer.
J’aime revoir les tableaux pour réaliser à quel point la vision est fugitive, me confronter au souvenirs laissés par les impressions et approfondir ce que je n’ai fait qu’entrevoir lors de ma vision précédente. Enfin, j’aime approcher mon nez du tableau. Certains musées qui n’ont pas encore investi dans d’intempestives sonneries d’alarme le permettent si bien que j’en éprouve presque de l’ivresse.
Et pourtant.
Une certaine idée de l’accrochage
La Galerie Doria-Pamphilij à Rome présente sa collection sous la forme d’un de ces accrochages que l’on retrouve dans plusieurs musées italiens. Les tableaux s’accumulent sur chaque mur depuis un mètre jusqu’au plafond, avec peu d’écart entre eux. Un éclairage inégal en laisse certains presque complètement dans l’ombre. Précisons que l’aménagement actuel des tableaux de la Galerie est issu d’un plan d’accrochage du XVIIIème siècle qui a été retrouvé dans les archives de la famille. S’il ne favorise pas la vision de toutes les pièces, cet accrochage offre donc un intérêt historique quant à une certaine conception de la possession et de la monstration des œuvres. En l’état, on est confronté à une sorte d’artothèque plutôt qu’à une exposition telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui.

Parmi plus de 500 toiles se trouvent quelques morceaux de choix : plusieurs Caravaggio, le fameux portrait du pape Innocent X par Diego Velasquez, une descente de croix de Hans Memling, une annonciation de Fra Filippo Lippi, Le Titien, Raphaël, Vasari, Le Guerchin, Claude Lorrain, Pieter Brueghel l’Ancien, Parmesan, etc. Ces toiles ne sont pas toujours positionnées au niveau le plus visible et sont relativement disséminées, si bien que les peintres les plus fameux de la collection en côtoient d’autres moins célèbres voire méconnus. A lever les yeux à plusieurs mètres de hauteur, le vertige nous prend souvent et le regard a parfois du mal à s’extirper d’une certaine confusion, rendant l’expérience esthétique incertaine.
Au début, tout allait bien. L’objectif était clair : j’étais venu voir des tableaux, sans savoir exactement lesquels, mais certains plutôt que d’autres. Afin de visiter le musée correctement, c’est-à-dire sélectivement, je m’étais affublé de sortes d’oeillères mentales. Surtout, je me laissais diriger par ma mémoire : vue à distance, telle image éveillait un écho qui révélait que j’avais dû déjà la voir dans un livre. Elle était connue puisque reproduite et diffusée. Dit comme ça, ça paraît un peu stupide mais qui peut dire qu’il agit autrement en visitant un musée ?
Un trouble s’installe
Assez rapidement, l’expérience esthétique s’avéra des plus troublantes. D’abord, il y avait tant de noms qui m’étaient inconnus que j’ai rapidement cessé le petit jeu de la mémoire. De plus, dès que je repérais un tableau célèbre, mon regard ne parvenait pas à se concentrer uniquement sur lui mais vagabondait vers ceux qui l’entouraient. Il arriva alors que lorsque je tentai de justifier intérieurement ce qui pouvait me rendre admiratif ou dédaigneux d’une toile, je n’y parvins plus.
En quoi le peintre du chef-d’oeuvre devant lequel je me tenais était-il plus admirable que l’auteur, plus obscur, de la toile adjacente ? Sur quels critères d’analyse pouvais-je baser ma hiérarchie de goût ? Et était-elle aussi personnelle que je voulais bien le croire ? Parfois, je m’appuyais sur la recherche d’un style plus ou moins affirmé. Ce qui caractérisait ce style tenait à des éléments aussi différents qu’une thématique (les paysages mythologiques de Poussin), des formes de système compositionnel, une certaine palette de couleurs, et peut-être même une touche, laquelle est particulièrement visible pour des peintres tels que Le Caravage, Le Titien dans sa dernière période et, emblématiquement, Le Greco. Mais cette approche catégorisante se trouvait parfois désarmée. Par exemple, confronté à des oeuvres de Raphaël, je suis objectivement à peu près incapable de reconnaitre sa patte. Enfin, dans mes tentatives de discernement, il n’y avait aucune réelle logique. Ici une exagération de la forme dessinée m’apparaissait comme une preuve de style tandis que là, elle me semblait une maladresse.
J’en vins à me demander ce que j’étais vraiment venu chercher ici. Certainement pas une extase contemplative mais plutôt un questionnement sur mes certitudes esthétiques, ce qui est après tout un bon point de départ pour vivre, précisément, une expérience esthétique. Perdu dans une forêt de signes, je me trouvais dans un état de flottement presque agréable, me demandant vers quel tableau j’irais si je ne savais rien de l’histoire de l’art. A moins que je ne me dégage des images peintes. Je pourrais alors me fixer sur le phénomène d’accumulation d’oeuvres comme symptôme de la société d’une époque…

Se défaire d’une forme de savoir
Revenons aux images. Se défaire d’une histoire trop bien apprise et intégrée n’est pas si simple. Car insensiblement, cette histoire finit par conditionner nos goûts et notre échelle de valeur. Est-ce que, si nous parvenions à nous en dégager, tout se vaudrait et se dissoudrait dans une forme de relativisme esthétique ? Probablement pas, mais il faudrait commencer par interroger à nouveau ce qui, à nos yeux, valorise une œuvre : sa nouveauté dans l’histoire de l’art, sa singularité, la maîtrise du savoir-faire technique, la biographie de son auteur ?
Certes, l’expérience esthétique est vécue intimement. Et j’ai été marqué, aux Beaux-Arts, par l’enseignement d’Alain Bonfand, qui filait de nombreuses métaphores entre la rencontre esthétique et la rencontre amoureuse. Aussi entière, indicible et impossible à transmettre que le coup de foudre amoureux, la véritable expérience esthétique, selon lui, précédait et excédait ce que nous pouvions en dire.
Parce qu’il avait déjoué mes attentes, le hasard était devenu mon complice. Il avait contribué à m’abstraire de ce qui est trop su, trop connu, trop évident. A ne pas identifier, ne pas reconnaître, ne pas faire jouer mon érudition. Il était alors devenu possible de franchir les couches de ce que j’avait digéré et transformé en certitudes. Afin d’atteindre un point où le regard pourrait précéder le désir de rendre le monde intelligible.
Le site de la Galerie Doria Pamphilij