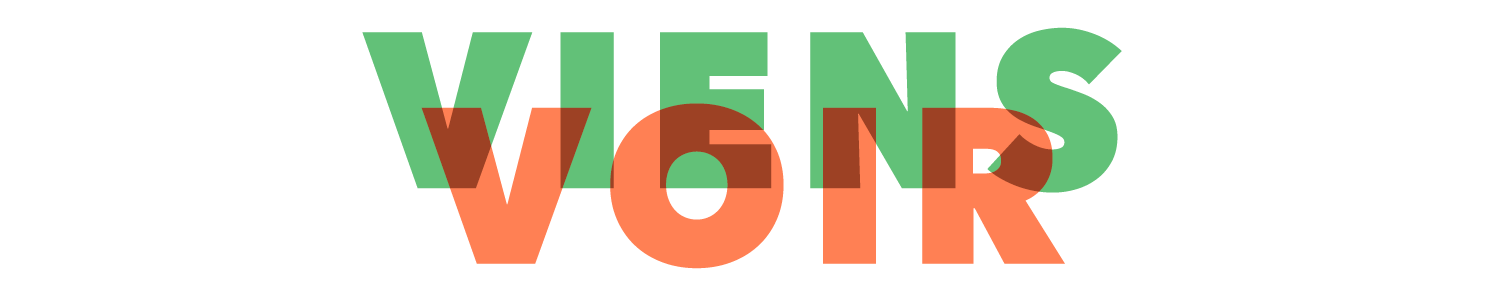Le portrait photographique permet-il vraiment d’approcher l’autre ? Limites et potentiels du genre à travers l’exploration d’un album photo un peu particulier…
C’est un album de photographies à l’odeur presque animale. Mais peut-être est-ce l’imagination qui, considérant le dromadaire qui orne la couverture fatiguée, vagabonde. Nous l’appelons l’album de la Guerre d’Algérie, puisqu’il contient les photos prises pendant le service militaire de mon père, de novembre 1959 à janvier 1962. Celles-ci documentent essentiellement la vie du bataillon, portraits en tenue militaires ou dans la chambrée, blagues potaches, quelques paysages de baraquements ou de la campagne algérienne.
Deux images dissonnantes
Au milieu de toutes ces images qui évacuent presque complètement le contexte de guerre, deux notes dissonnantes, qui ouvrent sur d’autres vies que celles qui occupent majoritairement l’espace du cadre.
Sur la première photographie, un groupe de six enfants alignés. Trois d’entre eux regardent l’opérateur, deux soeurs (?) détournent la tête et le dernier abaisse le regard sur des sortes de plaques rectangulaires que lui et deux autres tiennent entre leurs mains.

Sur la seconde photographie, mon père pose à côté d’un jeune garçon. Les années passant, le tirage surexposé a pâli mais on devine, à l’endroit où leurs deux mains pourraient se toucher, une petite tortue en équilibre sur le muret.
Parmi toutes les photos de l’album, seules ces deux-là laissent entendre qu’il y avait sur cette terre d’Algérie une autre population que ces mâles à peau blanche portant l’uniforme la plupart du temps, plus rarement en short et torse nu pour une partie de volley-ball.

Un genre en soi :
le portrait de voyage
S’il y a un genre photographique qui me met mal à l’aise, c’est bien celle du portrait rapporté de voyage. Sadhu en sari d’une belle teinte orangée, alignements d’enfants au sourire candide, vieillards burinés aux costumes pittoresques, beautés lointaines espiègles ou mystérieuses, ces photos d’une trouble séduction parlent d’un instant fugitif, sans conséquence. A travers ces clichés, quelle véritable rencontre avec un autre corps, quelle expérience de l’autre, quelle mise en jeu de soi-même ?
Rien n’a vraiment changé depuis que les photographes-voyageurs du XIXème siècle s’emparaient de l’exotisme pour transmettre du rêve ou du fantasme bon marché. Dans ces photos, aujourd’hui comme hier, il est question de la domination de celui qui prend l’image sur celui qui la subit. Le premier se l’approprie, le second s’y prête (un peu comme les serfs, au Moyen Âge, étaient prêtés au seigneur pour la corvée).
On raconte que les autochtones qui découvraient la photographie craignaient que ces boîtes à images manipulées par les touristes/colons ne vinssent dérober leurs âmes. Peut-être n’avaient-ils pas tort après tout : en capturant ces visages et en les détachant de leur terre natale pour les exposer à des milliers de kilomètres de là, à quelle opération croyons-nous procéder, si ce n’est à une forme d’expatriation ?
Pourtant, tous ces portraits se ressemblent-ils ? Répondent-ils tous aux mêmes besoins ? Et savons-nous lire toute la charge qu’ils portent ?
Dans la mémoire du photographe
On mesure son bonheur quand, soixante trois ans après qu’une photo ait été prise, on peut décrocher son téléphone pour parler de deux photographies avec leur auteur, celui qui les a désirées.
Si les souvenirs de mon père étaient flous, c’était, me confirma-t-il, parce que « ces deux photos correspondaient à des évènements isolés. Aucun de ces enfants n’avait laissé de trace particulière dans sa mémoire. Ils étaient, selon ses mots, simplement des enfants de la mechta. Peut-être sortaient-ils de l’école, une construction très rudimentaire, sur la place de Brazza, aujourd’hui Zoubiria. »
Trop de temps avait passé, je ne me faisais guère d’illusion en lui demandant ce qui avait pu le pousser à vouloir ces photos. Pourtant sa réponse a fusé : « j’avais un souci humanitaire, je voulais montrer qu’il n’y avait pas seulement des combats, que les algériens n’étaient pas des ennemis pour moi. »
Mais tu connaissais ces enfants ?
« Non, je les avais rassemblés sur le moment. Et pour les… appâter, pardon pour le mot, je leur avais donné des biscuits de rations de l’armée. Ce sont les petites plaques rectangulaires que l’on distingue dans les mains de trois d’entre eux. Quant au jeune adolescent, il venait parfois dans la grange qui nous servait de caserne pour proposer ses tortues. Les militaires les achetaient pour les rapporter ensuite à leurs familles, en France métropolitaine. »
Donc tu avais organisé ces photos pour faire passer précisément cette idée de présence pacifiée ? C’est plutôt une forme de propagande, non ? (je le sentis se raidir)
« Non, non, le mot est trop fort, je voulais montrer des sentiments de paix, qui étaient aussi ceux que je ressentais. Tu sais, je n’étais pas le seul à faire ce genre de photos. »
Mais il y avait certainement dans ton bataillon des soldats qui, au contraire, n’auraient jamais pris ce type de photos ?
« Ah oui, ceux qui étaient allés en opération sur le terrain ne considéraient pas du tout les algériens de la même façon. Moi je n’y suis jamais allé.
Ces photos, je les ai prises aussi pour rassurer ta maman, mes parents, mes frères et ma soeur. Je suis rentré en permission deux semaines plus tard et je les ai données à développer. Je voulais partager avec eux ce que je vivais. »

Le « je » de l’opérateur
Dans ces deux photographies, il y a du clair et du trouble.
Ce qui est clair : dans cette opération, une seule personne est dans la position de dire « je ». C’est l’opérateur. Le pouvoir est entre ses mains. Qu’il en use avec plus ou moins d’éthique ne change rien. La relation est fondamentalement déséquilibrée.
Mais il y a aussi quelque chose de plus trouble : ce « je » n’est pas qu’un « je », car il est lui-même pris dans un réseau de volonté et de significations qui le dépassent.
Il y a deux dimensions dans la photographie. La première réside dans le discours sur le monde qu’élabore l’opérateur aidé de sa machine : c’est ce qui est représenté à l’image. La seconde, la dimension psychique, dévoile un pan de la vie intérieure de l’opérateur : elle en est l’image en miroir.
Ainsi, au moment de la prise de vue (novembre 1960), le brigadier Dubreuil était-il le tout jeune père d’un garçon de cinq mois (mon frère) qu’il n’avait vu qu’une poignée d’heures, lors d’une permission exceptionnelle accordée quelques jours après sa naissance. Que pouvait-il ressentir de sa propre condition en rassemblant ces enfants devant le regard photographique et en s’accolant à l’un d’eux ?
Il n’était pas qu’un prédateur de l’image. A travers elle, il questionnait ses sentiments autant qu’il jetait des ponts avec celles et ceux qui étaient au loin.
Le vrai visage de la photographie est quelque part entre ces deux dimensions.

Un souvenir sans image
Il y a autre chose.
A la fin de notre discussion, il me raconta une anecdote que j’entendis pour la première fois.
« C’était à Boghari (aujourd’hui Ksar el Boukhari) en septembre 1961. Ce soir-là, je devais porter les restes de nourritures dans des grands bidons-poubelles qui étaient derrière nos baraquements. En arrivant, j’ai trouvé deux petits gamins qui plongeaient à pleines mains dans les poubelles et mangeaient les haricots qu’ils remontaient. Ça m’avait mis les larmes aux yeux. Je leur avais dit d’attendre et leur avais rapporté des assiettes à manger… »
« Ça m’avait mis les larmes aux yeux. »
Ce souvenir-là est sans image.
Ce jour où j’ai appelé mon père, il est venu à la parole sans mise en scène ni préméditation. Ces larmes (et quand il me raconta le souvenir, sa gorge se resserra à l’instant de dire cette phrase), c’était le don de la rencontre.
Ce souvenir-là est sans image car la photographie peut aussi être un obstacle à la possibilité d’être touché par l’autre.