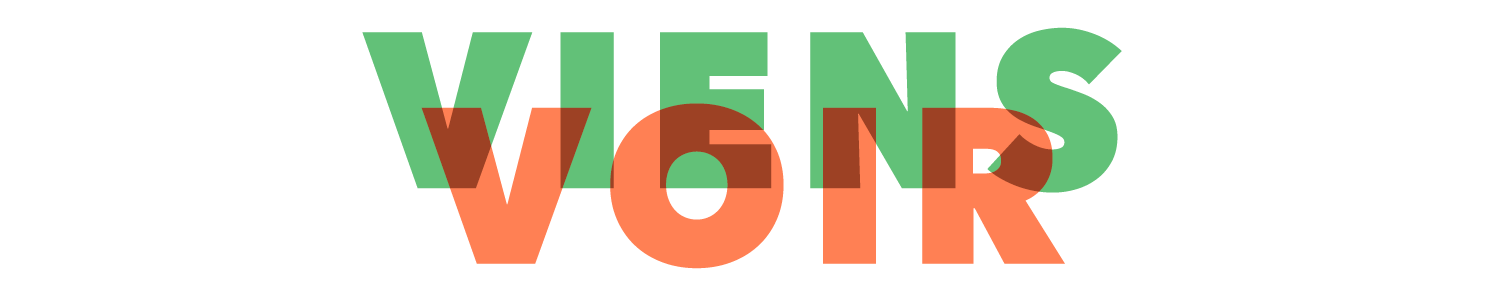Déterminer le sujet d’une photo n’est pas toujours facile. Mais ça peut devenir l’enjeu passionnant d’un travail sur l’image capable de nous entraîner bien loin du réel représenté.
Quel est le sujet de cette photo ?
Quand je pose cette question, certains de mes étudiants me regardent un peu étrangement, comme si j’étais subitement devenu aveugle et que l’évidence m’échappait. Ils se mettent alors à dérouler les éléments successifs du visible, établissant entre eux une hiérarchie qui privilégie d’abord les figures vivantes, puis calcule la surface occupée par les principaux élément matériels de l’image.
Le sujet de la photo
ou l’objet de la photo ?
La matérialité est ici un critère déterminant. En effet ce qui est immatériel, par exemple le ciel, ne serait identifié comme sujet qu’en dernier recours : si jamais il occupait une large portion de l’image mais qu’il était traversé par quelques nuages, ce sont eux qui deviendraient le sujet de la photo.
La netteté des éléments entrera ausi en ligne de compte : ainsi un premier plan flou sera-t-il délaissé au profit d’un second plan net, même si celui-ci occupe une beaucoup plus petite surface de l’image.
Le raisonnement parait presque logique. Mais il confond la lecture du sujet avec un inventaire du visible. Et plutôt que du sujet de la photo, on devrait ici plutôt parler de l‘objet de la photo.
Alors, nous pourrions peut-être compter sur le titre pour nous renseigner. Mais bien souvent, le titre se révèle si banalement descriptif qu’il finit par appauvrir la photo : ainsi « La petite fille au ballon rouge » ne recèle-t-elle nul plus grand mystère qu’une petite fille… Tenant un ballon rouge !
Ou bien le titre peut se révéler si dénominatif et informatif qu’il finit encore par adhérer strictement à l’image, mais d’une autre manière, laquelle ne nous aide guère quant au type de lecture à appliquer à la photo (voir Adrian Walker, la photo de Jeff Wall dans la troisième partie de notre série sur la photographie objective et perceptive ).
En filigrane, se pose la question de la manière dont notre regard investit la photographie, ce qu’il en attend, ce qu’il y cherche et ce qu’il y trouve.

Les deux types de regardeurs
Et là, on peut dire qu’il y a deux grandes voies possibles, comme deux typologies de regardeur.
Le premier va coller strictement au réel. Il voit dans la photo un évènement arrêté qui l’intéresse surtout dans sa dimension d’indice. La photo est pour lui le support d’un réel qu’il faut identifier et au besoin, élargir spatialement et temporellement. Ce regardeur s’attachera aux circonstances exactes de la prise de vue aussi bien qu’aux intentions du photographe. Pour lui, la vérité est dans l’image, ou en amont de l’image. Une lecture totalement opérante pour des photos historiques et documentaires, mais qui l’est moins pour des images plus poétiques ou discursives. Ce regardeur peut même parfois faire preuve d’une certaine candeur, confondant le réel photographié avec le réel tout court. Mésestimant donc la capacité du photographe à transformer la réalité.
Car le photographe travaille avec le réel, il ne le subit pas.
Le second type de regardeur s’attachera moins à un strict décodage du réel qu’au rapport entre les formes à l’intérieur du cadre. Sa lecture donnera plus d’importance à ce que produit la photo qu’à ce dont elle est le produit. Elle s’intéressera donc plus à l’aval de l’image qu’à son amont, rétablissant le lien entre l’artiste et le spectateur, là où la première lecture a tendance à abandonner tout pouvoir au photographe. Ce regardeur décollera plus facilement du réel. Il saura s’extraire d’un sens qui se construirait uniquement à partir de l’analyse contextualisée pour atteindre plus aisément une poétique, voire une métaphysique de l’image.
L’idéal serait évidemment de concilier les deux approches : faire appel à la contextualisation quand c’est nécessaire, et savoir s’en abstraire pour donner à la photographie tout son statut d’objet artistique.
Grandir en photographie
C’est une photo de Koudelka qui m’a permis de modéliser différentes approches de la photographie, en me renvoyant à ma propre démarche et à mes questionnements. Qu’est-ce qui, selon mon âge et mes expériences, aurait attiré mon attention ? Qu’est-ce que j’aurais voulu capter, montrer ?
Je devais avoir environ quatorze ou quinze ans quand m’a été offert mon premier appareil photo. C’était comme une sorte de rite de passage. Mon père nous offrait un appareil, comme pour dire que nous devenions assez grands pour porter notre propre vision du monde. Une ou deux années auparavant, une première étape avait déjà été franchie dans les rares moments où il nous laissait manipuler l’appareil pour quelques cadrages dont la maladresse ne laisse aujourd’hui guère de doute quant à leur attribution.
Je n’avais aucune culture photographique, bien peu de technique et encore moins d’idées. Je cadrais des choses pour les attraper comme on rabat le filet sur le papillon. Et les seules images-papillons qui m’attiraient se reconnaissaient dans des sujets préalablement identifiés : si ça ressemblait à une photo, ça devait mériter d’en devenir une.
Alors, j’imagine que face à la scène dépeinte dans la photo de Koudelka, je serais resté focalisé sur la figure du jongleur. Probablement aurais-je réalisé que la photo serait plus réussie si la balle avait quitté la main. De là à chercher l’instant exact où la coupure de l’horizon la mettrait à égale distance de la main, créant un équilibre dans cette instabilité, je crois que le pas aurait été trop grand. Je ne l’aurais tout simplement pas envisagé, ni pour le sens, ni pour l’aspect formel. Premier temps.

Deuxième temps, quelques années plus tard. Je ne me serais pas contenté de la figure du jongleur, j’aurais élargi le sujet, en quête d’une géométrie des formes. J’aurais peut-être perçu le losange qui se dessinait si je reliais entre elles les trois figures et la quatrième, celle du petit hangar sur la colline. Je me serais donc dégagé du sujet du premier temps pour me concentrer plus sur les formes. Sans verser pour autant dans une photo purement formelle : la circularité entre les formes pourrait faire écho au cercle du jongleur lorsqu’il joue avec de multiples balles.

Troisième et dernier temps, encore plus tard. Ne pas avoir de stratégie pré-conçue. Recevoir le monde plutôt que lui donner forme. Vagabonder plutôt que construire. Savoir que le monde dit plus que ce que j’ai vu. Alors, avoir peut-être vu le jongleur et le losange, mais vouloir autre chose, vouloir plus, à côté, ailleurs : le cheval, cet appel de l’ailleurs, comme un appel d’air qui ouvre l’image sur la droite, la faisant échapper à un équilibre trop parfait. Le choix d’un réel un peu bancal, imparfait, vivant.

Une image qui, plutôt que de rassembler et concentrer le visible, le retient et le laisse aussitôt s’enfuir. Du sable fin.
Finalement, c’est peut-être ça qu’on apprend en photographiant, à laisser le monde nous échapper.
(A suivre)